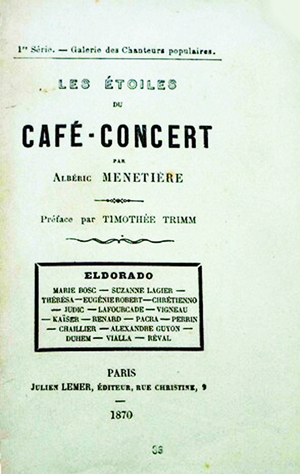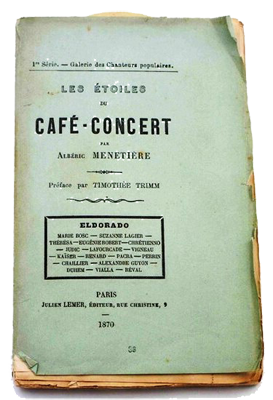Les Étoiles du Café-Concert
|
 ote : Un moteur de recherche passablement connu qui scanne les livres des bibliothèques, qui laissent faire, indique que cette publication qui date de 1870 appartient désormais au domaine public et la publie. Nous choisissons dl'intégrer notre exemplaire in extenso à notre site afin de permettre l'établissement de liens entre ses différents paragraphes et certaines de nos pages thématiques. L'avalanche de dithyrambes au style ampoulé lassent très vite et peuvent fausser totalement la perception que l'on peut avoir des sujets cités ! Mais cela reste un avis, une opinion de nature à comprendre l'époque et le métier ! Bonne lecture ! ote : Un moteur de recherche passablement connu qui scanne les livres des bibliothèques, qui laissent faire, indique que cette publication qui date de 1870 appartient désormais au domaine public et la publie. Nous choisissons dl'intégrer notre exemplaire in extenso à notre site afin de permettre l'établissement de liens entre ses différents paragraphes et certaines de nos pages thématiques. L'avalanche de dithyrambes au style ampoulé lassent très vite et peuvent fausser totalement la perception que l'on peut avoir des sujets cités ! Mais cela reste un avis, une opinion de nature à comprendre l'époque et le métier ! Bonne lecture ! |
LES ÉTOILES DU CAFÉ-CONCERT
PAR ALBÉRIC MENETIÈRE
Préface PAR TIMOTHÉE TRIMM
PARIS
JULIEN LEMER, ÉDITEUR, RUE CHRISTINE, 9
__
1870
______________________________
Argenteuil.--- Imprimerie P. WORMS
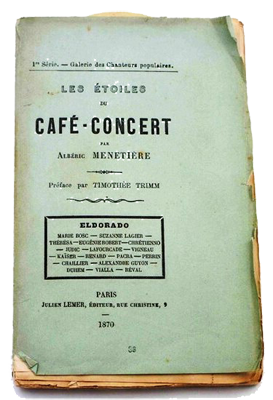

PRÉFACE
Le jeune auteur des Étoiles du Café-Concert me fait l'honneur de me demander quelques lignes d'Introduction,
Quelque chose comme une Ouverture, une Symphonie préparatoire... une Invitation à la valse.
Hélas ! je suis de ceux qui ne savent pas distinguer sur le cahier de musique un mi d'un la.
Je ne connais pas une note !
Est-ce un état d'infériorité ? Quelques logiciens soutiennent que c'est un avantage.
On juge par le cœur, l'esprit, la sensibilité non calculée, au lieu d'appr?cier en mathématicien comme un professeur du Conservatoire.
On ne vendrait pas cent montres dans l'Empire français, si on n'en vendait qu'à ceux qui exercent la profession d'horloger.
Il serait malheureux que ceux-là seuls qui savent battre un trille ou faire une roulade fussent appelés à juger exclusivement la douceur des chants de la Fauvette et du Rossignol.
Donc , j'ai peut-être des qualités suffisantes pour tracer en quelques lignes, non un péristyle à l'œuvre de mon jeune confrère,
Mais tout au moins un modeste seuil sur lequel se pouront rencontrer les amis de la Musique.
J'étendrai donc, comme un simple tapis, ces quelques lignes qui précéderont son consciencieux travail ;
Et j'espère qu'elles ne feront pas reculer le lecteur, quelque instruit ou dédaigneux qu'il soit.
Monsieur Menetière édite une galerie intitulée les Etoiles du caf?-concert, comme M. de Voiguyon édite en ce moment les Etoiles du Chant;
Seulement M. Menetière s'attache à ces missionnaires de l'art qui le popularisent dans toutes les classes.
Il est bon de vanter la voix de la Patti, le dramatique de la Krauss, les notes suraig?es de la Nilsson.
Mais il est excellent de faire connaître au peuple les talents, les mérites des artistes qui chantent leurs refrains devant lui, et dont quelques-uns seraient dignes de figurer sur les scènes les plus élevées.
On a dit que la voix du peuple était la voix de Dieu.
Cela est fort bien, mais à la condition que le peuple chantera juste,
Que, dans une chansonnette, une romance, une partie dans un chœur, il ne demeurera pas au-dessus ou au-dessous du ton.
Or, les artistes du Café-concert sont ses initiateurs du goût musical. Ils créent la justesse d'oreille de l'auditeur.
L'instruction obligatoire de la musique n'a pas besoin d'être ordonnancée,
Les Cafés-concerts l'ont mise depuis longtemps à la mode.
Les annales des Cafés-concerts donnent donc raison à la nature du travail de mon jeune confrère.
Le Café-concert a formé des élèves au Théâtre tout aussi bien que les Conservatoires :
Berthelier, Michot, Madame Ugalde, Mademoiselle Sass sortent des cafés-concerts.
La vogue des artistes en renom.dans ces estaminets lyriques est si grande que, leurs appointements sont souvent supérieurs à ceux donnés par tel ou tel impressario de scène subventionnée.
Et: M. Menetiére, en abordant ce sujet, pourrait renverser l'axiôme du Cardinal qui disait :
Ils chantent, ils paieront.
En disant : Ils chantent, ils sont payés.
Donc, bon succès à ce livre et à ceux qui le suivront.
Bon accueil à cette collection qui sera appréciée par les virtuoses du Peuple, si dévoués à leurs artistes favoris.
TIMOTHÉE TRIMM.
AVANT-PROPOS
Nous sommes en plein règne du Café-concert.
Et le peuple français, né chansonnier autant que malin, a consacré ces divertissements comme une substance essentielle à son être. A preuve l'extension qu'ont pris ces établissements.
Je sais que les gourmets de Beau, les raffinés dans leurs jouissances, exhalent une interjection de dédain au seul nom de : Café-concert ! Une parodie prosaïque et grotesque, pour eux !
Le principe est établi. Reste le but.
Il serait regrettable que cette récréation, agréable et populaire, se maintint dans l'état où nous la trouvons aujourd'hui, c'est à dire : la spéculation combinée du bock avec l'exhibition lascive des danseuses de ballet et de corde; j'entends comme on nous en donne le spectacle dans les établissements secondaires. Une autre destinée lui est réservée.
Ce jour là auront reflori la vraie Chanson et l'intrigue sensée.
Alors, ce jour là, le peuple viendra égayer son esprit à une source intelligente ; ce jour-là, le Café-concert sera : le théâtre à la portée de tout le monde. C'est que, comme le théâtre, le Café-concert sera universellement une école de mœurs. Car, pour citer de M. Pierre Véron : "Le Café-concert n'a pas pour but de faire descendre l'Art jusqu'au tréteau, mais bien de faire monter le tréteau jusqu'à l'Art"
De cette plé?ade d'établissements lyriques, qui sont presque aussi nombreux dans Paris que les Bouillons-Duval, l'Eldorado seul entre tous a réalisé jusqu'à présent notre dire; seul il est à l'heure présente un temple de l'Art. Seul il justifie la qualification de Théâtre populaire, et de bon goût.

Beaucoup de gens ne veulent apercevoir dans cette institution comme dans le théâtre, du reste qu'une distraction à gros sel ou un passetemps banal, un rendez-vous où l'on va pour rire ou tuer le temps, et ne se rendent pas
compte que derrière ce masque de l'interprétation et de l'exécution, il y a quelque chose de noble et de sublime qu'on appelle : Art.
M. X... me rit au nez, parce que je lui parle d'Art, de Beau, au Café-concert !,
Mais tout a sa poésie et sa sublimité ! Une goutte de rosée, un rayon de soleil sur une haie d'aubépine en fleurs, sont des choses, sinon ridicules, risibles pour M. X..., un banquier.
Un profane.
Mais quels suaves errements n'inspirent-elles point au poète, à l'artiste, qui a le don de percevoir des sensations fines et délicates? De quelles beautés ce rien n'énivre-t-il point son âme ?
L'étude des choses nobles projette leur reflet sur la physionomie de ceux qui les cultivent. L'art est comme l'amour. "Montrezmoi une femme amoureuse qui soit laide," dit quelque part Gavarni dans ses lettres intimes. En sorte qu'être artiste, signifie qu'on est un être marqué parmi les autres pour avoir subi une vocation impérieuse, inéluctable; s'être donné à l'Art qui vous obsédait ; pour avoir suivi, néophyte se heurtant à chaque caillou et se déchirant à chaque ronce, la Muse qui vous entraînait dans le chemin difficile qu'elle parcourt à grands coups d'aile.
L'Art est comme une sorte d'apostolat glorieux ; on verrait volontiers une petite auréole au front de chacun dé ceux qui portent le nom d'artiste. C'est une race à part.
Il est vrai qu'en ces jours d'abâtardissement moral, l'Art a perdu de son prestige et de ses prérogatives. L'Art, une aristocratie est devenu un état, comme l'Administration. Mais il a encore des adeptes.
J'ai, ailleurs, esquissé d'une façon badine et superficielle, dans un livre intitulé : les Binettes du Café-concert, les différents types' de l'Artiste, mais généralisés sous l'emploi qu'il tient. Cette publication n'a rien de commun avec l'autre, légère et oiseuse.
La Littérature et le Théâtre ont eu leurs biographes. Pourquoi le monde du. Café-concert, classe intelligente et artistique, n'auraitil pas le sien ?
Je m'impose sans prétention.

Avant de terminer, je veux exprimer à M. Léo Lespès toute ma gratitude, en le remerciant de tout mon cœur d'avoir bien voulu faire viser par Timothée Trimm le passeport des Etoiles du Café-concert.
L'ELDORADO
Et d'abord, il serait absolument injuste de ne point abandonner une large place à l'Historique du caf?-concert en général, à l'Eldorado en particulier.
Dans le principe, le caf?-concert ne fut qu'une goguette. Un chanteur juché sur trois planches maintenues par deux tonneaux, attirait la foule autour de lui. Tel fut le berceau du caf?-concert'
On goûta les plaisirs du chant, tout en fumant sa pipe et en buvant de la bière. La scène improvisée devint le Café-concert des Aveugles. La concurrence s'en mêla. La perfection survint.

Au mois de juin 1858, on fit les fouilles pour construire l'Eldorado, dont l'emplacement était alors occupé par le manége Pellier, qui avait son entrée par le faubourg Saint-Martin.
Mme veuve Grelet, à qui appartenait le terrain, en fit la concession l MM. Lecharpentier et Dubosc pour quarante années, moyennant la somme annuelle de 32,000 francs.
Ceux-ci, voyant l'extension que semblaient prendre les cafés-concerts, conçurent le plan d'un établissement modèle et firent exécuter, par l'architecte Duval, l'Eldorado tel que nous le possédons actuellement. C'était splendide.
L'Eldorado, par sa construction monumentale, sa grâcieuse architecture et sa magnifique façade, prenait le premier rang parmi les établissements lyriques ; sa décoration élégante et sa supériorité affirmaient la vogue à ses directeurs. Tout promettait que le succès devait couronner l'entreprise. L'ouverture eut lieu le 24 décembre de. la même année.
Mais l'heure n'était point encore sonnée ; et le café-concert, dans les langes de la Vogue, n'excitait point, certes, cet enthousiasme et cet amour qu'il rencontre aujourd'hui. Après une exploitation infructueuse de seize mois, la faillite Lecharpentier et Dubosc fut déclarée.Ce qui contribua surtout à cette catastrophe, ce furent les frais énormes que coûta la construction. Le devis avait été fixé à 300,000 francs, et la facture s'éleva à 900,000 francs ; ce fut assurément ce débordement imprévu qui entraîna le naufrage des premiers impressarii.
Le fonds fut vendu en avril 1860, sur une mise à prix de 150,000 francs à M. Bonhomme, qui l'obtint avec une seule enchère de 100 francs.
En faisant cette acquisition, M. Bonhomme, de concert avec M. Sary, directeur des Délassements-Comiques, avait pour but de transformer en théâtre le caf?-concert de l'Eldorado. A cet effet, ce dernier avait obtenu de l'Administration d'y transférer son privilège.
Mme Grelet qui, selon une clause spéciale de son bail, avait vendu le terrain pour l'exploitation, exclusive, d'un café-concert, s'opposa à l'érection d'un théâtre.
De là procès. Bonhomme et Sary ont gain de cause en première instance. Appel de Mme Grelet, et cassement du premier jugement, avec confirmation, en faveur de Mme Grelet, pour l'exploitation unique d'un café-concert à l'Eldorado.
Les travaux qu'exige une scène dramatique avaient été commencés ; il fallut remettre les lieux en état. M. Bonhomme, demeuré seul alors, resta d'avril à octobre sans ouvrir, tandis qu'un loyer immense pesait sur lui.
C'est alors qu'un nommé Bayard rien, dit-on, du Chevalier sans peur et sans reproche proposa à M. Bonhomme la somme de 300 francs par jour pour la location de la salle. Le marché fut conclu.
L'Eldorado marcha ainsi du mois d'octobre 1860 à mai 1861.
Le sieur Bayard, aussi peu heureux que ses prédécesseurs, ne sut point, lui non plus, tirer parti de son entreprise.
C'est alors que M. Lorge, le directeur actuel, acquit l'Eldorado, le 15 mai 1861. Plus habile, peut-être aussi plus sérieux, il fit prospérer cet établissement et l'a placé an rang qu'il occupe aujourd'hui, c'est-à-dire : le premier concert de Paris.

Ces notes, peu intéressantes pour le lecteur et arides dans leurs détails, étaient cependant essentielles, pour établir d'une façon nette et précise quel fut le point de départ du Café-concert; car les premiers établissements de ce genre, tels que le Géant, le café Moka et celui de France, piètres initiatives, ne fournîrent qu'un résultat pour ainsi dire neutre.
Ce fut l'Eldorado qui, le premier de tous, innova au profit général le plan confortable dont nous jouissons actuellement; la série diverse des places à l'instar des théâtres ; la suppression du renouvellement dés consommations, ainsi que la pose des artistes sur la scène, coutume peu digne de l'Art et qui n'existe plus que dans quelques établissements tout à fait inférieurs. C'est à l'Eldorado, en somme, que nous devons toutes les mesures progressives, l'élan donné à cette nouvelle branche de nos divertissements, et le développement qu'ils ont acquis. Si le café-concert jouit aujourd'hui de quelques libertés, dont nous sommes les premiers à goûter les faveurs, c'est encore à l'Eldorado que nous les devons. Et, dussé-je blesser la modestie de M. Lorge, je dois déclarer que c'est sous son impulsion que le ;caf?-concert a conquis tous ces avantages, que nous apprécions.
La gestion de M. Lorge mérite certainement les plus grands éloges ; car, c'est à lui seul que nous sommes redevables de tous les agréments et de toutes les améliorations entrées au café-concert ; c'est à lui seul que nous devons son émancipation.

Un événement, appréciable pour tous, et assez notable pour que nous en parlions, puisque toute la Presse s'en empara à l'époque, fut l'introduction du costume sur les scènes des estaminets lyriques.
Il serait injuste de passer sous silence la révolution à laquelle cette revendication donna lieu, et dont une liberté fut le fruit.
Au temps où nous parlons, c'est-à-dire en 1866, la loi qui émancipait les théâtres eut pour effet de léser les cafés-concerts, jusqu'à prétendre à leur ruine. Ces derniers, restreints, opprimés sous des mesures rigoureuses, ne possédaient pas le droit du travestissement. Tout se chantait irrévocablement en habit noir et en costume de ville.
Toute la presse parisienne, du grand et du petit format, unanimement, embrassa la cause de ces faibles. La Gazette des étrangers, la France, le Petit journal, le Bouffon, le Foyer, la Petite presse, le Nain jaune, l'Opinion nationale, le Siècle, la Vie parisienne, l'Époque, le Camarade, Parismagazine, l'Europe artiste, la Patrie, l'Étendard, l'indépendance belge, un journal anglais même : Lloyd's weekly london newpapers, et particulièrement le Figaro qui avait attaché le grelot, firent campagne contre le ministère.
Voici le fait :
On se souvient sans doute d'une tragédienne émérite quoique méconnue, Mlle Cornélie, qui, quelque temps au Théâtre-Français, avait tenu le sceptre de la puissante Rachel.
Un jour, au grand étonnement d'un certain monde à préjugé, on vit le nom de cette éminente artiste sur l'affiche de l'Eldorado. Grand émoi, vous pensez, chez ce monde pour qui l'art au café-concert est une injurieuse parodie. On taxa d'audace.
Cependant M. Lorge, qu'en qualité de directeur on montrait au doigt ainsi que ses confrères, . comme sacrifiant aux faux dieux, pour me servir de l'expression de ces puritains, ne s'en émut point. Et les Rossini, les Verdi, les Demidoff et tutti quanti sommités ne dédaignèrent point de manifester, par leur présence, leur adhésion à cette noble tentative. Là s'agita la question du costume.
Mlle Cornélie, qui trouvait, comme le public, infiniment prosa?que et ridicule de dire en crinoline et en robe benoîton les Imprécations de Camille, le Songe d'Athalie et les Fureurs d'Hermione, sollicita du ministère l'autorisation de chausser le cothurne et d'endosser le peplum. On permit exceptionnellement. Il devint non moins grotesque de voir un monsieur en fauxcol droit, tout de noir habillé, donner la réplique, dans les dialogues, à l'artiste costumée selon les règles de la tradition; et, sur la logique de ce raisonnement, le ministère sollicité accorda la seconde permission, toujours exceptionnellement.
Cependant, tourmentés par les agressions de la presse, vaincus par cette sorte de petite guerre de liberté artistique, les hommes prudents et graves qu'on appelle les Censeurs, chargés de veiller à la santé morale et à la vertu du peuple français, autorisèrent universellement le travestissement an caf?-concert. La cause était gagnée. Merci, M. Lorge.
On a beaucoup ri d'abord ceux qui ne se sont pas scandalisés de cette tentative digne de toute approbation, dont le directeur de l'Eldorado fut le promoteur.
L'estrade des cafés-concerts semblait uniquement vouée aux exhibitions de Thérésa et à la propagation des élucubrations ineptes de cette diva de contrefaçon. Un homme, prenant son rôle au sérieux, imagina un progrès, un progrès intelligent, méritoire. Elaguant de son répertoire le genre grossier et d'un goût plus que douteux, a conquis à la fois une liberté légitime et nécessaire, et prouvé en même temps que ce publie,qu'on dédaigne est aussi susceptible du vrai sentiment, d'apprécier le Beau, que cette autre cohorte à gants beurre-frais et à carreau dans l'œil.
Ce public, le peuple, l'a prouvé en récompensant la tragédienne par d'enthousiastes bravos, et en approuvant, par son assiduité, les efforts généreux tentés par M. Lorge.
La tragédie n'est point déplacée au caf?-concert. L'Art est partout à sa place.
Eh ! mon Dieu, Molière jouait bien les Femmes savantes dans une grange.
MARIE BOSC
I
Nous avons tenu à ouvrir cette série des figures célèbres au Café-concert par une artiste véritable et méritante , savante et digne , par Mlle Marie Bosc, à qui, selon notre sentiment, le premier rang revient de droit. Mais, nous le déclarons pour la suite, aucune hiérarchie ne sera suivie dans l'ordre de la publication, pour ne pas heurter les susceptibilités , ni marquer en cela une supériorité de mérite ou une préférence personnelle, ne voulant pas non plus provoquer des discussions appréciatives, cas fort épineux et subordonné au goût de chacun.
Je n'ai fait de distinction que pour celle à qui, d'un commun accord, les gens de goût ont décerné leurs faveurs sans restriction.
Au nom de la gaieté française, les cafés-concerts ont arboré l'ineptie absurde, sous le pseudonyme d'élucubration, dans le goût du Sapeur et de la Femme à barbe, précurseurs des Pompiers de Nanterre. On ne doit point appeler gaieté ce qui excite le rire ; mais un certain charme, un air agréable qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux.
Une espèce de rivalité, j'oserai presque dire d'antagonisme, semble animer les principaux artistes, dans les différents genres, au Café-concert.
J'entends parmi les célébrités.
La chanteuse légère revendique les droits de la supériorité sur la comique très excentrique, et celle-ci , à son tour , prétend primer celle-là. L'une évoque le Droit ; l'autre la Vogue.
La question n'a pas besoin d'être discutée ; elle se résout d'elle-même. Il y a la différence de l'art au talent.
Je n'ai pas l'intention de rabaisser par là le mérite de la seconde au bénéfice de la première.
Je tiens simplement à distinguer deux attributions diverses, infusibles, dont je déclare l'une plus noble et plus élevée que l'autre, partant plus appréciable. Ceci n'enlève en rien du mérite personnel. Chacune y jouit de ses avantages propres, mais d'une nuance distincte.
Il est vrai que, contre tout sentiment du délicat et du grâcieux, l'approbation générale aurait fêté l'excentrique au détriment du noble et` du distingué ; mais c'est un signe des temps.
Il s'est présenté ici, et au sujet de ces portraits lyriques, une question de primauté, purement d'appréciation personnelle, et à laquelle il est important de répondre avant toute autre chose.
--Vous devez commencer par Thérésa ! m'a-t-on dit.
Je répondrai : Non. -- Voici pourquoi :
C'est que je n'accorde aucune concession, au point de vue de l'Art, .à l'interprète du Sapeur. Thérésa a su exploiter avantageusement une monstruosité vocale, dont elle a bénéficié innocemment, par hasard, et sans le savoir. Elle ne s'est pas dit : Je dois réussir, parce que j'ai du talent et du mérite; mais je réussirai, parce que mon genre est un phénomène. Ce sera un succès de curiosité.
Je n'attribue sa vogue --éphémère-- qu'à l'engouement irraisonnable d'un public blasé et dégénéré, qui veut substituer le Neuf quand même au Vieux Beau, et qui l'a applaudie parce qu'il a a trouvé cela drôle, mais non comme l'expression d'une conviction unanime et sensée. Succès de grotesque, dont l'exhibition est plutôt digne des tréteaux des champs de foire que de la scène du Café-concert.
Voilà pourquoi je ne commence pas par Thérésa.
Voilà pourquoi je commence par Mlle Marie Bosc, qui n'est point une diva de contrefaçon et que j'estime nonseulement une artiste sérieuse et véritable, mais encore la .première chanteuse de nos établissements lyriques.
II
C'est à Paris qu'est née Marie Bosc, dans une maison de la rue Saint-Denis, le 6 août 1840.
Son enfance ne fut marquée par aucun incident fatidique. An contraire de certaines célébrités, qui aiment à travestir leur personnalité des paillettes de la prédestination, celleci ne revendique nullement de ces antécédents stéréotypés, qui vous consacrent élus de par le Destin.
Artiste d'une valeur irrécusable, elle a conscience de son talent, et, ne se sentant pas appréciée à son juste mérite, elle déplore cette insouciante estime dont elle demeure entourée.
--Ah ! monsieur, me disait-elle un jour en se plaignant avec mélancolie de l'enthousiasme modéré qu'on lui manifestait, il ne m'a manqué qu'une seule chose pour être une grande artiste : c'est de ne pas avoir chanté dans les cours avec une guitare !
Ah ! comme je comprends cette amertume de l'artiste qui a la foi, faisant de son art un culte et s'y vouant religieusement, et qui voit préférer, par un public indolent ou qui ne la comprend pas, les refrains les plus vulgaires et quelquefois les plus grossiers aux accents de l'âme, aux notes suaves et aux plus douces modulations.
Mais l'assentiment et la sympathie des vrais amateurs, des gourmets, récompense amplement de l'impression pénible qu'inflige l'indifférente action des gens neutres. Et Mlle Marie Bosc jouit, certes, de ces compensations là.
Si Marie Bosc n'a pas chanté dans les cours, comme la moindre cantatrice de l'Opéra, elle n'en a pas moins aimé à chanter et, toute petite, roucoulait elle du matin au soir comme un guilleret rossignol.
Douée d'une affection naturelle pour la musique et douée en outre de cordes vocales les plus harmonieuses, elle faisait déjà l'admiration de ses parents et des amis du foyer.
--Chante-nous quelque chose, Marie ? lui disait chacun qui venait.
Et de s'exécuter de la meilleure grâce, sans se le faire demander deux fois, je vous en réponds.
Elle eût volontiers donné audition de son répertoire toute la journée.
Elle poussait même le scrupule de la tradition et de la couleur locale jusqu'à ôter sa robe et paraître avec sa petite chemise décolletée, imitant le plus sérieusement du monde les chanteuses pour de bon.
Son père étant venu à mourir, on la mit au couvent, où elle demeura depuis l'âge de neuf ans jusqu'à quinze.
Paresseuse, indolente pour la science, disalent ses maîtresses, elle préférait de beaucoup les instants de la récréation aux heures de la classe. Toujours la chanson au bout des lèvres, légère et distraite, la supérieure lui faisait un crime de son étourderie et de son inaptitude classique.
La mutine écolière était insensible aux remontrances.
A quinze ans, jugeant qu'elle était suffisamment instruite, elle sollicita sa mère de la retirer de la pension.
Elle fut mise en apprentissage, tour à tour chez une couturière et chez une repriseuse de cachemires. Elle remplissait l'atelier de sa suave et joyeuse voix, chantait toujours, et faisait peu de besogne.
Arrivée à l'âge de seize ans, elle sentit naître en elle une violente aspiration qui la poussait vers la carrière lyrique.
Elle jeta l'aiguille aux orties.
Ce fut alors qu'elle entra au Théâtre Lyrique, dans l'emploi de coryphée.
Mme Carvalho brillait à cette époque de tout son éclat, et Marie professait pour elle une admiration sans bornes.
Elle se tenait dans les coulisses, muette et recueillie, buvant pour ainsi dire chaque note qui sortait de la bouche de l'éminente artiste, l'accompagnant intimement et rêvant déjà, pour elle-même, les lauriers qu'on prodiguait à Mme Carvalho.
Elle me l'a dit maintes fois depuis : Ce sont là les meilleures leçons que j'aie prises.
Un incident regrettable lui fit quitter le Théâtre Lyrique.
M. Carvalho, le directeur, avait monté les Noces de Figaro avec le plus grand soin. Les rôles étaient tenus par les principales sommités. Celui de Fanchette avait été départi à Mlle Girard.
Par la suite, après les premières représentations, on chargea Marie Bosc de l'interpréter.
Au bout de soixante représentations, M. Carvalho gratifia généreusement sa pensionnaire de la somme de soixante francs soit un franc par soirée.
Notre coryphée froissée dans son amour-propre, --c'était légitime-- abandonna de ce jour le théâtre de M. Carvalho.
?tant au Lyrique, Mlle Bosc fit partie pendant six mois du Conservatoire, à titre d'auditeur.
Voyant qu'on ne voulait pas la faire chanter --était-ce mauvais vouloir, ou négligence simplement ?-- elle en est sortie.
A partir de cette époque, elle s'adonna ientièrement au café-concert, qu'elle n'a plus quitté.
III
Elle débuta, en 189, au café de France, situé sur l'emplacement du Palais Bonne-Nouvelle aujourd'hui, et dont M. Goubert était directeur.
Elle y entra par hasard, pour y remplacer une artiste absente. Elle n'y resta que dix jours seulement.
De là, elle alla au Cheval-Blanc.
Les principales étapes de sa carrière lyrique sont le Cheval-Blanc, pendant trois ans; l'Alcazar, cinq ans, et l'Eldorado.
Dans l'intervalle, elle a rempli plusieurs engagements dans les différents concerts de Paris.
Marie Bosc a l'âme affectueuse et sensible au suprême degré, se souvenant avec une reconnaissance touchante des marques de sympathie dont elle a été l'objet.
En 1861, étant chez M. Aublin, aux Folies-Dauphine, où son talent était déjà justement estimé, un musicien du haut monde, M. Georges de Montmigny, sollicita son concours pour un concert qu'il donnait à la salle Herz.
Elle y chanta l'Ave Maria, de Gounod, avec une telle suavité, un tel charme, qu'elle recueillit tout le succès de cette soirée musicale. C'est le plus beau triomphe dont elle aime à se souvenir.
Il faut le dire aussi, malgré tout le talent qu'elle
peut déployer, le public qui compose l'auditoire des cafés-concerts est tellement mélangé, que les vrais appréciateurs ne forment qu'une faible minorité, quand là elle avait une salle tout entière d'élite, des dilettanti de la plus délicate venue.
Du reste, Mlle Marie Bosc a souvent chanté dans les bénéfices, à l'Athénée, aux Variétés, etc., et toujours partout, on a su rendre hommage à ses qualités rares de diction et de morbidesse, admirant l'éloquence avec laquelle elle égrène les perles de ses vocalises.
Et M. Bussine, de l'Opéra-Comique, son professeur, doit être bien légitimement fier de son élève.
IV
On a fait volontiers de la cloison Guilloutet une planche à bouteilles. Mlle Marie Bosc ne nous en voudra pas trop si, abusant de la construction défectueuse de l'architecte, nous pénétrons un peu dans sa vie intime pour en trahir quelques particularités.
Le sentiment de l'amour Est la perception du Beau par excellence, et l'amour filial est sans contredit le premier parmi ces sentiments nobles.
Marie Bosc joint à la sensibilité et à la compassion natives de l'artiste, le cœur le plus généreux et le plus dévoué.
Vivant au milieu de sa famille, dont elle est le soutien, elle a voué son existence au bonheur de sa mère, pour laquelle elle professe une piété et un dévouement sans limites.
Depuis l'âge de neuf ans, époque où elle perdit son père, elle ne lui a jamais donné un sujet de mécontement, sérieux ; et, depuis l'âge de seize ans, elle l'a soulagée et soutenue de tous ses efforts dans la lutte si âpre de la vie, subvenant elle seule aux besoins de leur double existence, pour lui épargner les fatigues matérielles et laborieuses qui usent et abrègent insensiblement les quelques moments que nous avons à passer ici bas. Et c'est bien.
Sa vie, qui pourrait être une vie joyeuse, de fêtes et de plaisirs, se passe simplement au foyer, appréciant davantage le bienêtre de l'intérieur et les pures jouissances de la famille que le.mirage illusoire et faux de ce qu'on appelle les joies mondaines , séductions factices et énivrements creux.
Douce, bonne par excellence, franche et affable, telle est l'impression qui charme au premier abord le visiteur.
Sa physionomie est intelligente, vivement animée par deux yeux noirs et brillants comme l'esar boucle, qui l'illuminent de leur reflet et impriment à la moindre oscillation de leur orbe une animation minutieusement spirituelle.
Au foyer, parmi ses camarades, elle passe généralement pour une mauvaise coucheuse ; car elle n'est jamais en retard pour la répartie. Sa franchise lui a attiré plus d'une fois les inimitiés de compagnes susceptibles.
Femme, elle aime infiniment à causer; et sa conversation est des plus attrayantes. Spirituelle, elle Pest assurément; elle manie la pointe et le mot trèsvolontiers, mais sans en faire ostentation. Il lui arrive parfois d'en décocher de cruels.
Je ne veux en citer qu'un, entre autres :
Un jour une camarade , Mlle Trois ?toiles , après avoir essuyé une veste désastreuse, revenait au foyer, la, mine piteuse.
Un titi, des régions célestes, avait même poussé l'oubli des convenances jusqu'à lui adresser le projectile traditionnel, que vous savez.
--Ai-je été huée! disait-elle à Marie Bosc.
--Au contraire, ma chère, lui répondit celleci; tu es une chanteuse pommée.
Il se passe au café-chantant une lutte continue de la Vulgarité contre la Distinction. La multitude ne se fait pas l'injure de nier absolument ce que chérit l'élite, mais elle se contente de l'appuyer mollement, avec une insouciante modération qui est presque la négation, réservant ses explosions effrénées d'enthousiasme pour la joyeuseté triviale et la sotie au gros sel, de préférence aux accords mélodieux de la lyre et aux beautés savantes de la science réelle.
Bien entendu que je mets ici en dehors tout parallèle entre artistes ; je n'établis de rapprochement qu'entre les interprétations et non les interprètes.
Je veux protester contre ce goût, et je ne saurais choisir une meilleure place pour le faire, qu'en ces pages dédiées à celle qui personnifie au caf?-concert la Muse ellemême de l'Art lyrique.
Il faut véritablement avoir perdu toute délicatesse des sensations, tout raffinement de l'exquis, pour préférer aux chefs d'œuvre les inepties absurdes qu'on sert en pâtée aux voraces spectateurs. Ils se pâment d'aise là.
Il en est pourtant des beautés artistiques ce qu il en est des beautés naturelles : personne ne songe à protester contre le prestige d'un coucher de soleil, et nul ne se détourne de la rose pour rendre hommage au pissenlit.
D'où provient donc que ?ce public, sceptique ou blasé, rongé par la routine ou le contresens, soit insensible au Beau, pour jouir suprêmement des éclats épais de la Vulgarité !
Il me serait aisé d'en découvrir la source.
Les appétits matériels et le goût trivial que l'innovation Théréséenne ont mis à la mode en sont sans doute la cause ; et ils ont trop facilement dégénéré en habitude.
Si la vraie chanson, celle de Désaugiers et de Béranger, revenait en faveur, peut-être une louable transformation s'opérerait elle dans l'intelligence appréciative du public. Ce serait à souhaiter.
En attendant, force nous est de subir et de digérer cette pâtée vulgaire et dénuée de jouissances fines, dont je parlais tout à l'heure.
Je ne veux pas être exclusif : aussi je ne vote pas sans réserves à l'extinction des Sapeur et des Trou lai la, mais je demande qu'on rende justice à qui de droit, quand ce ne serait ,que pour notre décence personnelle.
Aimez-vous la moutarde ? On en a mis partout.
Assurément c'est un abus.

Je voudrais me résumer par un portrait exact du talent de Mlle Marie Bosc. Je tâcherai d'en esquisser le plus vraisemblablement qu'il me sera possible les tons et les délicatesses.
C'est incontestablement une artiste consommée et savante. A une voix souple et étendue, d'une exquise pureté et d'un registre élevé, elle unit le don natif du goût et une méthode excellente. A ces qualités de la virtuosité, elle ajoute le sentiment vrai du morceau. Pleine d'expression, elle détaille à ravir les nuances exquises de la musique; passant avec une merveilleuse facilité des notes de poitrine à celles de tête, qualité rare chez une chanteuse légère.
A une grâce simple et modeste , qui s'ignore pour ainsi dire, elle joint une physionomie des plus sympathiques.
Et, si nous devons terminer par notre sentiment personnel :
SYMPATHIE ET ADMIRATION.
SUZANNE LAGIER
I
Je fus un jour rendre visite à Mme Suzanne Lagier. C'était dans son appartement de la rue de la Bruyère -- avant le terme d'octobre.
Je fus introduit dans un salon, ni style Renaissance, ni style Louis XV, ni style Impérial assurément, car les images de nos Républicains ardents émaillaient la muraille ; c'était un salon d'artiste. C'est-à-dire un fouillis de meubles de toutes les époques, de tous les goûts, mais à coup sûr de précieux meubles. Des fleurs, des potiches, des albums, des livres, toutes sortes de bibelots I tout cela courait sur la table et par terre ; sur la cheminée, fixée entre le socle et le globe de la pendule, la photographie de Troppmann était ostentiblement placée. Une véritable fournaise embrasait le foyer. Dans une moelleuse ottomane, la maîtresse de céans était béatement étendue à l'orientale, fumant une cigarette dont elle filait les bouffées avec une volupté de gourmet.
Mon arrivée ne sensibilisa pas le moins du monde cette bienheureuse que je venais troubler dans son farniente, car elle entretint la conversation sans démarrer. Ce n'est point un reproche, certes ; car j'aime infiniment cette jouissance asiatique, cette sorte de béatitude idéale et inaccessible.
Après avoir échangé les principes qu'enseigne la Civilité puérile et honnéte qu'on a coutume de se débiter mutuellement quand on a l'honneur de se faire visite, la conversation tomba fatalement sur l'artiste. Et je ne fus pas peu étonné, lorsqu'elle m'apprit son intention formelle de quitter le monde artistique, en renonçant au théâtre, à ses pompes et à ses œuvres.
Suzanne Lagier plantant des choux à Saint-Mandé ou à Bougival!
Cet excès de chauvinisme me surprit chez une mondaine comme Suzanne. Et, la raison qui la guidait dans cette détermination, avait pour motif : son fils, âgé de 18 ans, qui sortait du collège et allait entrer dans la vie. Pour ne point lui donner le spectacle d'une vie désordonnée et malsaine, elle a tout sacrifié : plaisirs, bonheur, égo?sme, ambition ; la femme a immolé à la mère.
La chronique a fait volontiers de Suzanne Lagier une femme légère et frivole, une libertine quelquefois même. Mais comme elle est femme au fond ! Comme on retrouve sous ces instincts de fille évaporée cet "éternel féminin" dont parle Gœthe. Voilà un fait.
II
Et d'abord Suzanne Lagier n'test point la première venue.
Elle descend en ligne directe, du côté de sa mère, de l'illustre Parmentier, ce bienfaiteur de l'humanité qui dota le pauvre de la pomme de terre. C'est une noblesse qui en vaut bien une autre.
Suzanne Lagier est née à Dunkerque, le 30 novembre 1833.
Ses parents qui, sans être très riches jouissaient d'une certaine aisance, ne négligèrent rien pour lui donner la meilleure éducation. Et, de très bonne heure, l'envoyat--on à Paris, dans un des meilleurs pensionnats.
Suzanne, naturellement intelligente, apprit avec beaucoup de facilité ce qui lui était enseigné ; aussi ses maîtresses la considéraient complaisamment comme un petit prodige.
Dans son enfance, elle manifestait déjà une inclination très prononcée pour le théâtre et, à douze ans, elle avait débuté à l'ÉcoleLyrique, qui florissait à cette époque. Elle y joua, dans une pièce intitulée le Mariage enfantin, le principal emploi.
M. Nestor Roqueplan, qui la vit s'acquitter si bien de son rôle, fut surpris du talent précoce avec lequel elle avait rendu son personnage. Il lui proposa de l'engager pour le théâtre des Variétés.
Inutile de dire avec quelle joie la nouvelle comédienne accueillit la proposition.
C'était au mois de juillet 1846. Élle débuta sur cette scène dans la Veuve de quinze ans. Londres nous l'envia. Elle partit pour passer quelques mois seulement au théâtre de Covent-Garden.
De retour à Paris, elle entra au Palais-Royal, où elle débuta dans le Démon de la famille. C'était vers 1848.
Suzanne avait l'humeur voyageuse, et préférait le soleil étranger ; les bravos et les adulations ne lui manquaient pourtant pas à Paris. Mais, non ; c'était dans son caractère. Elle partit pour SaintPétersbourg où elle fit un séjour de deux années.
Revenue de nouveau à Paris, elle alla à l'Ambigu, résolue à ne plus jouer que le drame.
Ses amis redoutaient pour elle cette mutation extrême. Ce genre lui réussit à merveille, et la Veuve de quinze ans et la Fille terrible se montra aussi pathétique dans le rôle de "Gabrielle" de Mademoiselle de Belle-Isle et dans " Geneviève" de Jean le Cocher qu'elle avait été désopilante dans ses premières créations.
Plus tard, Bocage qui montait la Tour de Nesle au théâtre de Belleville, offrit à Suzanne le rôle de "Marguerite". Elle accepta, et se pénétra tellement de son personnage, que l'on peut affirmer que pas une actrice avant elle n'avait interprété avec autant de vérité la cruelle et passionnée reine de France. Aussi, alla-telle le jouer un grand nombre de fois à la Porte-Saint-Martin.
Relater ici la carrière dramatique de Suzanne Lagier serait oiseux. Son passage sur la scène fut un triomphe. C'est assez dire.
III
Ce fut en 1865 seulement que Suzanne Lagier débuta au café-concert. C'était à l'Eldorado.
D'aussi étranges débuts excitèrent au dernier point la curiosité parisienne. Et tout le Paris des premières assistait-il.
Ce fut une véritable solennité, dont les journaux politiques même parlèrent le lundi. Roqueplan termina ainsi son feuilleton : "Par le piquant de sa diction, par l'esprit de sa physionomie, Suzanne Lagier a gagné le public ; elle a trinqué avec lui."
Suzanne Lagier est ce qu'on appelle"une bonne fille" dans toute l'acception du mot, charitable, sensible et faisant le bien par conviction et pour sa propre satisfaction.
On s'est complu à en faire un phénomène de corpulence monacale. Elle est plantureuse, j'en conviens; mais cependant, de l'image qu'on en fait à la vérité, il y a assurément beaucoup d'exagération. N'empêche qu'en scène, l'embonpoint ne la gêne pas plus que ça!
Sans prétendre aux charmes physiques, Suzanne Lagier a une figure qui plait. Elle séduit par la bonhomie.
Au don de la comédienne, elle joint aussi celui du compositeur. Suzanne Lagier est excellente musicienne, et c'est à elle que nous devons, entre autres : la Polka des baisers, la Ronde dis printemps, Jupiter et Léda de charmantes choses.
Pour terminer, je détache du Charivari ce médaillon, un amusant portrait de Suzanne, dans le Panthéon de poche des célébrités contemporaines.
a Elle a fait de tout, elle a joué tout, elle a été partout. On l'a vue en muse tragique, on l'a applaudie dans les mélodrames, on a échangé avec elle des plaisanteries au caf?-concert. Elle a été jalouse à la fois de Mme Dorval et de Thérésa. Tout au contraire de pierre qui roule... Suzanne a, dans ses pérégrinations, amassé une santé de fer et une corpulence de déesse. Si vous la rencontrez dans un escalier de théâtre, inutile de vous ranger ; il faut descendre ou remonter, vous ne passerez jamais."
THÉRÉSA
I
Thérésa
I
Je ne ferai point la biographie de Thérésa, ce serait commettre un double emploi. Elle a publié ses Mémoires.
Cette confession, quoique incomplète, puisqu'elle n'y fait point mention ni de son nom de famille ni de son extrait de naissance, deux points qui paraîtraient essentiels pour des Mémoires , est , à vrai dire , moins sa propre biographie que l'histoire de ses voisins. Elle consacre les neuf dixièmes de son ouvrage à nous initier aux mœurs du boulevard, à nous mettre au fait des cascades de M. X... et de Mlle*** et à nous apprendre que Timothée Trimm s'appelle Léo Lespès.
Cette existence imprévue et inespérée, éphémère, peut se résumer en deux lignes .
"Une artiste qui, après avoir cabotiné longtemps, s'est trouvée un beau jour cueillie par le Hasard."
Aucun fait en dehors qui ne rentre dans la vie de tout le monde; aucune éclaircie, aucun rayon de soleil remarquable dans ce ciel monotone qu'on appelle l'existence, n'a marqué sa personnalité, illuminé sa carrière lyrique. Une popularité d'un moment est venue seule l'éblouir comme un éclair, l'étonner dans son calme, presque la troubler dans son cours.
Ses Mémoires portent en suscription : "Je dédie ce livre à celui à qui je dois tout
..........au Public."
Elle eut été plus 'dans le vrai en l'offrant au Hasard, à la veine, si vous aimez mieux ; ?car elle est jaillie du Hasard.
II
Sa réputation date de 1867, l'année de l'Exposition.
Ille avait débuté à l'Eldorado, et on ne l'avait pas remarquée. Ce fut le directeur de l'Alcazar qui l'inventa, dans un réveillon où on la fit chanter. Elle écorcha si bien ou si mal le morceau qu'elle dit, que l'ingénieux impressario, trouvant cela drôle, résolut d'en offrir la primeur à son public. Ce public trouva cela drôle, et applaudit de toutes ses forces. Il n'en fallut pas davantage.
Eh ! mon Dieu, oui : voilà toute l'histoire du talent de Thérésa ; voilà toute la cause de son succès. Quand je vous disais : flamme de bengale !
Cet engouement dura deux ans, après lesquels elle voulut battre la province. Elle ouvrit sa campagne par Marseille, mais elle fut bien vite désillusionnée ; car les indigènes de la Cannebière, moins cléments que les bons Parisiens, lui firent promptement son procès.
Jugez-en plutôt par ce compte-rendu d'un journal local :

"En même temps que Don Juan faisait salle comble au Grand-Théâtre, l'Alcazar s'évacuait au bruit des huées et des sifflets de la foule, et Thérésa n'avait pas encore chanté. Qu'aurait ce donc été alors ?
Ces manifestations peu sympathiques, et bien dignes de la diva Forte-en-g.................. , sont la réponse du
peuple à ceux qui se figurent qu'il suffit de battre la grossecaisse pour remplir la leur. Nous l'avions prévu le directeur est resté seul
fumant dans la salle ! ! !
--Pas si bête le Marseillais !" Le Casino s'en est ressenti : il refusait du monde, ce soir-là ; mais le motif était loin d'être le même : RENARD CHANTAIT.
"Ceci nous dispense de tout éloge. En présence de la banque sans vergogne, faite à une crieuse de galette, le véritable artiste n'avait qu'à attendre sûr de l'emporter.
"Nous sommes heureux de voir que Mlle Thérésa a contribué un peu, quoique indirectement, au succès du vrai mérite."
La leçon était sévère, dure même. L'audace était grande aussi.
Monter sur le piédestal de la Renommée, affublée d'un type grotesque qu'on prétend faire passer pour de bon goût est le comble 'de l'impertinence. L'engouement qui a salué son aurore n'était point un argument sur lequel Thérésa devait s'appuyer ; et ce fut là son tort.
Sans vouloir critiquer de parti pris, la vogue exaltée jusqù'à la frénésie dont elle fut l'objet, ne justifie pas une réputation controuvée, jusqu'à la jucher sur l'échelon où sont assis les. Renard et les Patti. C'est tout au plus une excuse. Et n'est-il pas pénible de voir de semblables individualités primer des artistes véritables !
Je considère Thérésa comme un phénomène. Et il y a toujours un certain public qui aime ces curiositéslà. Succès de grotesque ! Voilà sa vogue.
Son genre est une parodie, et je n'aime pas la parodie, quand elle passe à l'état d'autorité. Qu'on applaudisse le comique excentrique burlesquement drôle, je l'approuve ; mais je n'apologierai jamais le comique excentrique pour de bon. On me taxera peut-être de puritain. Mais, que voulez-vous ! Je préfère Faust au Petit Faust, Gounod à Hervé, Mme Miolan-Carvalho à Blanche d'Antigny.
III
Depuis sa disparition de la scène lyrique, Thérésa est complètement plongée dans les limbes de l'oubli. Le Parisien, né capricieux, a offert ses caresses à d'autres étoiles , et , disonsle à sa louange, il a fait preuve d'un meilleur goût.
Cette vogue éphémère est passée; aujourd'hui, la Thérésa du Sapeur et de la Femme à barbe est morte pour le public. En vain, quelques directeurs, se disant : Thérésa doit faire recette, ont-ils engagé cette diva bouffe. Le public est indifférent.
Et il m'est pénible, en vérité, de lire actuellement sur l'affiche de nos théâtres le nom de Thérésa en vedette, à l'instar des Patti, des Nilsson, des Carvalho et de tant d'autres célébrités dont le talent et le mérite sont inviolables.
La Gaîté, qui a monté pour elle une vieille féerie, la Chatte blanche, en substituant le personnage de la duchesse de la Pigeonnière, à celui de Pierrette-Thérésa, me semble avoir pataugé avec le canard dont elle se fait l'incarnation.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Son rôle, surgi-là on ne sait pourquoi, est d'ailleurs sans raison. Et je ne sais rien de moins sain et de moins sensé que les interprétations dont elle s'est approprié le monopole. Il semblerait que, hors de l'inepte et de l'absurde, Thérésa serait déroutée ; on serait porté à croire aussi que la chanson des canards aurait été taillée sur le patron de ses succès d'autrefois. Jugez :
Quand les canards s'en vont en tas,
Qu'é qu' ça vous fait, ça n'vous r'gard' pas!
Ils n' s'occup' pas d' vot' société,
Laissez leur donc la liberté ! ! ! !
Des mots écorchés, agencés les uns au bout des autres, sans s'inquiéter si phrase, vers, couplet, pensée, ensemble, signifient quelque chose d'intelligible et,d'intelligent. Je ne saurais mieux comparer ces conceptions lyriques qu'à une bande des palmipèdes euxmêmes, dont elles sont la consécration. Et Thérésa et la Chatte blanche pourraient bien justifier le grand air du désespoir :
J'arros'rai plus d' citrouilles !...
Ma dernièr' adress', la voilà :
A la mare aux guernouilles !...
Je pense que l'école de Thérésa et de M. Boulet, l'impressario, servira à tous deux d'une profitable leçon , et persuadera la diva-choppa qu'elle n'est possible qu'au café-concert, son moins douteux élément, et que sa résurrection sur une scène dramatique est non-seulement de l'aplomb, mais encore de l'outrecuidance.
On peut être la Patti de la choppe, et, à ce titre, avoir commis un abus de renommée ; mais grotesque, on ne s'impose pas sur un théâtre, même jouant la féerie.
Je ne sais si Thérésa, revenant à fleur de caf?-concert, jouirait de la même appréciation et du même succès qu'autrefois ; mais je comprendrais et j'approuverais mieux ces tentatives.
Lafontaine a dit, comparaison à part, bien entendu :
Ne forçons point notre talent,
Nous ne ferions rien avec grâce.
Ce penseur avait raison, et son bon sens a encore cours de notre temps.
Si Thérésa, la populaire, au dire de ses confessions :
"Je suis une fille du peuple , et j'amuse le peuple, c'est ainsi que je trouve moyen de ne pas me séparer de ma famille!"
n'était point sortie de sa sphère, on pourrait excuser son débraillé artistique ; mais ses prétentions, ridicules parce qu'elles sont convaincues, sont loin d'attirer la sympathie : désertant un camp dont elle s'était fait un piédestal, reniant un drapeau qu'elle avait ostensiblement brandi.
Elle ressemble à nos politiques , orléanistes sous Louis-Philippe, républicains en 48, et bonapartistes sous l'Empire ; en un mot, girouettes tournoyant au vent des bonnes circonstances, oubliant complaisamment leurs professions de foi de la veille. Pour ceux-ci, c'est un crime ; pour celle-là, c'est une apostasie.
Aujourd'hui, Thérésa est morte à la vogue. Elle a duré ce qu'ont vécu les questions romaines, ce que dureront les vélocipèdes. Succès de mode, encore une fois : flamme de bengale.
Le seul droit qu'elle puisse revendiquer , est d'avoir doté le caf?-concert d'un genre, d'un vilain genre il est vrai, mais d'un genre inédit. Triviale jusqu'au cynisme, délurée jusqu'au débraillament, l'innovation dont elle fut l'auteur aurait dû inspirer à ses raffinés sans scrupule plutôt le découragement que l'enthousiasme , le hautdec&œlig;ur que la dégustation. Ce public compté, invariable, cette claque de convention mais y allant de bonne foi, n'a pas réussi à faire prendre d'absurdes grossièretés pour des hardiesses de style pittoresque, et une excentricité stupide pour une désinvolture fantaisiste.
D'ailleurs Thérésa a été unique dans sa façon, et celles qui s'intitulent chanteuses-thérésa n'ont point imité leur modèle, ni par la voix ni dans l'interprétation. Elles ont créé un genre à côté.
Enfin, pour m'appuyer d'une appréciation autorisée, je citerai ce mot que me disait un jour M. Léo Lespès, et qui cliche parfaitement cette silhouette lyrique :
"Thérésa n'est pas commune; mais elle est canaille."
EUGÉNIE ROBERT
I
Enfant gâtée !
Ainsi pourrait se résumer brièvement ce récit, et rendre, en somme, l'expression de son passage sur chacune des scènes où elle est passée.
Eugénie Robert doit sans doute les câlineries du public, dont elle a été l'objet, à une conformation physique frêle et délicate. Et, tout en applaudissant au talent, on entoure de bienveillantes caresses l'interprète dont la fragilité et le charme prédisposent naturellement à la sympathie.
Eugénie Robert a fait partie de cette école primitive qui a concouru à l'affermissement sérieux des cafés-concerts; elle a assisté à leur transformation d'infimes caboulots en palais fantaisistes, en châlets d'été, en un mot, en théâtres lyriques populaires, qui sont aujourd'hui la distraction la plus attrayante de nos soirées inoccupées.
C'est un titre, certes, à la sympathie des lecteurs; en outre : chanteuse fort goûtée et bonne comédienne, qualité trèsappréciable au café-concert.
II
Née à Paris, le ler février 1835, élevée sur les genoux des artistes, la carrière dramatique s'ouvrait tout naturellement devant elle.
Elle fit ses premiers débuts aux Folies Dramatiques, sous le nom d'Annette Robert, son véritable prénom qu'elle répudia plus tard pour prendre celui d'Eugénie lorsqu'elle embrassa le caf?-concert; elle avait alors dix ans. Elle remplissait à ce théâtre des rôles d'enfant avec une assurance et un goût déjà remarquables. Le public, charmé de la grâce na?ve et de la conviction avec laquelle elle s'en acquittait, lui manifestait amplement son approbation en la comblant d'oranges et de bonbons, marques les plus manifestes pour un enfant.
Enfant gâtée !
Un an après, elle tenait l'emploi de chef des chœurs au Cirque Napoléon,
Le fait seul de cette distinction, indique su ffisamment les capacités qu'on lui reconnaissait pour confier semblable poste à une artiste de onze ans
l'entourait des mêmes tendresses qu'aux Folies Dramatiques.
Mme Marie Robert, sa mère, artiste aussi, ayant éprouvé par elle-même les amertumes et les déboires de la vie artistique, voulut les épargner à sa fille et lui fit quitter le théâtre pour qu'elle apprît un état, celui de brunisseuse sur porcelaine. Annette avait alors quatorze ans.
Ce ne fut pas sans beaucoup de chagrin qu'elle y renonça. Adulée et fêtée, sans soucis du présent, alléchée par les promesses de l'avenir que lui faisaient présager ses premiers succès, elle n'avait pris que l'essence de la coupe sans en avoir effleuré l'amertume.
Elle versa d'abondantes larmes, puis se résolut. Toutefois nourrît-elle toujours au fond de son cœur un sentiment inextinguible pour la scène, entretenant l'espérance d'y rentrer un jour.
A dix-neuf ans, elle se maria, et, au contraire de ce qui aurait été plutôt supposable, la période de quatre ans qu'elle demeura avec son mari fut l'unique laps qui la vit infortunée.
Elle demeura pendant ce temps éloignée du café-concert. Elle y rentra pour ne plus le quitter en 1858. Ce fut au café Moka, de la rue de la Lune.
Avec les qualités dont elle était douée, elle ne tarda pas à y percer ; aussi recueillait-elle chaque soir un succès bien mérité.
Peu de temps après, Mlle Lucie Cico qui, avant d'être la charmante prima dona qu'elle est, chantait prosa?quement au café-concert la fit engager au Casino du Palais-Royal, où elle-même exécutait.
Les premiers fondements de la réputation d'Eugénie Robert étaient déjà posés, et le succès s'était attaché à son nom. Elle obtint au Casino du Palais-Royal de véritables ovations, et à chaque entrée en scène, elle était acclamée par un frénétique enthousiasme.
A cette nouvelle, le directeur du concert de la rue de la Lune, courut pour ressaisir l'oiseau envolé. Il le ramena et le fixa dans sa cage par un traité de quinze mois, pendant lesquels la renommée d'Eugénie s'affermit encore.
A partir de cette époque la vogue ne fit que l'escorter dans toutes ses pérégrinations lyriques.
Aux Ambassadeurs, avec : Un soir de carnaval. La Cigale de Paris, Fleur des Alpes, le Concert et la Cour et le classique duo de Frisette et Briochet.
Ensuite, à l'ouverture de l'Eldorado, M. Lorge l'engagea. Elle y reçut les plus glorieuses ovations. Elle y resta cinq ans, pendant lesquels elle ne s'absenta que deux hivers où elle alla à Bruxelles.
Il paraîtrait que les Belges sont plus ardents que nous, ,car les Bruxellois élevaient leur admiration et leur sympathie à l'état de culte. Elle y était littéralement adorée. Bouquets, couronnes et sonnets pleuvaient sur la scène.
A son retour, ce fut l'Alcazar qui l'accapara ; comme ailleurs, le succès l'y suivit.
Disons aussi qu'à tous égards Mlle Eugénie Robert, aussi bonne comédienne que bonne chanteuse, mérite à juste titre les sympathies dont elle a été l'objet de la part de tous les publics qui l'ont acclamée.
III
Nous sommes au mois de novembre 1868. En ce temps-là, Eugénie Robert voulut tenter la fortune pour son propre compte. Chacun paya son écot à la bienvenue, chacun l'encouragea de ses sympathies.
Voici ce qu'en disait le Gaulois :
"Mlle Eugénie Robert, ex-premier sujet de l'Alcazar, nous donne le lundi 9 novembre un concert à l'Elysée-Montmartre , 80, boulevard Rochechouart, à 8 heures précises du soir.
Tout Paris viendra entendre cette charmante artiste disparue de la scène depuis deux mois et que nous retrouverons plus mignonne et plus délicieuse chanteuse que jamais. Avis aux amateurs."
Malgré les artistes d'élite dont elle avait le concours, payant elle-même de sa personne, malgré un programme des plus souriants, elle n'a pu mener à bien son entreprise.
J'emprunte à l'?cho des Concerts le récit de l'insuccès de cette artiste.
"Les amateurs de café-concert, et particulièrement les habitués de l'Alcazar n'ont pas oublié, car ils la regrettent tous les jours Mlle Eugénie Robert qui savait charmer le public, et comme chanteuse de grands morceaux d'opéra et de romances, et comme comédienne dans les saynètes qu'elle interprète avec un talent si fin.
Mlle Eugénie Robert qui avait quitté l'Alcazar, pour prendre un repos dont elle avait grand besoin, vient de faire une tentative qui n'a malheureusement pas eu tout le succès qu'elle en attendait. Elle a organisé des concerts dans la salle de l'Elysée-Montmartre et son intention était de les continuer tout l'hiver, mais elle a dû s'arrêter au troisième.
Elle avait cependant réuni tous les éléments possibles pour attirer le public : orchestre de 25 musiciens; une troupe choisie, dans laquelle on remarquait la directrice d'abord qui payait largement de sa personne.
Malgré cet orchestre, cette troupe et une salle charmante et des mieux disposées Mlle Robert n'a pu arriver à faire ses frais."
Ajoutons, puisque nous le tenons de source certaine, que non seulement Mlle Robert n'a pas fait 'ses frais, mais encore qu'elle y a perdu deux mille francs.
A l'époque où M. Arnaud, le directeur des Porcherons, monta son établissement, il eut grand soin de s'approprier Eugénie Robert en lui faisant proposer des appointements magnifiques.
Celle-ci contribua beaucoup à la, vogue qu'il conquit spontanément, car le nom d'Eugénie Robert sur l'affiche est un passeport pour une bonne soirée.
Mais l'été est venu ; les Porcherons ont fermé leur porte aux dilettanti, et le petit rossignol a pris son essor vers les ChampsElysées.
IV
Un fait, dont la particularité ne nous semble pas oiseuse, vient se glisser sous notre plume.
Il existe, à Montmartre, une société formée sous le nom de : Choral de Montmartre, et dont Eugénie Robert est un membre honoraire, non en vertu d'un droit abusif des femmes, comme cela se pourrait en nos jours, mais comme une marque honorifique de ses collègues.
Eugénie, qui ne sait refuser ses services à personne, n'avait jamais refusé de prêter son concours au bénéfice de l'orphéon de Montmartre. Pour la remercier et lui témoigner sa gratitude, la Commission l'a admise dans son sein et lui a conféré une décoration en argent comme titre de sa qualité. De semblables titres sont les meilleurs brevets de la meilleure noblesse, celle du cœur.
On serait porté à croire que, pour arriver aux premiers rangs et conquérir le succès, la connaissance de ses notes soit la moindre des choses. Eugénie Robert nous offre la preuve du contraire. Sans principes et sans notions musicales, douée par exemple d'un admirable instinct et d'une merveilleuse affinité, elle en a escaladé les sommets.
Jugez du résultat.
Voici ce qu'en dit un journal, rendant compte de l'ouverture du concert des Porcherons au mois d'avril 1869. Son appréciation sur l'excellente artiste résume aussi mon sentiment à son égard.
Si j'ai réservé pour la fin celle qui, ici, comme elle l'a eue partout où elle a passé, méritait la première place...
C'est que, je l'avoue, j'ai hésité, tremblé : ma plume d'écolier dessine des zigzags quand elle voudrait pouvoir esquisser à larges traits le portrait de cette bonne artiste qui a su se faire aimer
de tous, ainsi qu'elle s'est fait applaudir sans envies, sans jalousies, sans hypocrisies sincèrement, comme elle est sincère !
Toute petite de taille ; une physionomie fine, expressive et expansive ; des yeux brillants, chercheurs, malins ; la lèvre moqueuse , spirituelle ; un tout, enfin... tout petit et gracieux, c'est... elle !
Ecoutez-la chanter. Elle passionne, elle émeut, elle fait pleurer, quand elle interpréte la Lisette de Béranger, ou bien le Verre de Bohême.
Elle est gamin, gavroche, délurée d'allures, quand elle chante les Hirondelles de la rue.
Elle est cascadeuse, parisienne jusqu'au bout des ongles, pétillante, agaçante, entraînante, charmante, dans son rôle de Madame Putiphar du Manteau de Joseph...
J'ai nommé
EUGÉNIE ROBERT."
CHRÉTIENNO
I
L'artiste dont nous allons esquisser la vie, a une noble page dans les annales où sont enregistrées les célébrités.
Mlle Chrétienno, qui a charmé tour à tour le Théâtre et le Concert, est une artiste dans toute l'acception du mot, une ?toile de premier ordre.
Son nom a été murmuré dans toutes les bouches, ses refrains ont été salués de la déesse Popularité, et son succès est des plus méritoires.
Il arrive que le public, fantaisiste et capricieux, accorde parfois aveuglément ses faveurs à tel ou tel qui par une supercherie ou un talent factice arrive à escalader les degrés qui conduisent au au Capitole de l'Art. Mlle Chrétienno les a gravis un à un. Et c'est là son mérite.
Elle est arrivée au faite par sa valeur, et ses qualités ne sent point d'emprunt.
Sa voix est juste et forte, ample, vigoureuse, vibrante ; son talent, comme comédienne, est délicat. Pleine d'entrain, d'un goût exquis, elle dit parfaitement.
Nulle artiste n'a encore réuni tant de qualités diverses et supérieures; nulle n'est parvenue à ces nuances d'expression, à ces effets irrésistibles par la seule puissance de la voix, sans abuser jamais du geste ni de la physionomie.
A ces charmes, qui sont le talent, elle joint l'éclat de sa personne et le goût des toilettes. Elle captive, en un mot, son public.
II
Elle naquit à Paris le 28 juillet 1840. Son véritable nom est Chrétiennot, qu'elle travestit en entrant au théâtre par la suppression du t.
Douée d'une voix magnifique, elle était née avec l'amour du théâtre. Il n'en fallait pas davantage pour présager qu'elle serait fatalement une artiste.
Le théâtre Beaumarchais fut son école. Habitant la rue Saint-Antoine, on s'explique qu'elle choisit le plus proche, à défaut du meilleur.
A force de voir jouer, un désir violent d'af-fronter la rampe s'empara d'elle. Ses parents, qui goûtaient peu ses inclinations artistiques, n'auraient certes pas approuvé ses plans; aussi, afin de ne pas éprouver un refus, quitta-t-elle le toit paternel sans rien dire.
Ce fut au théâtre de Belleville qu'elle débuta, en 1859. Elle y resta une année, pendant laquelle elle eut le temps de s'y faire remarquer, car à
l'expiration de son engagement elle entrait au Vaudeville, qui la garda deux ans.
Au printemps de 1863, un impressario érigea au bois de Boulogne une scène lyrique baptisée sous le nom de Châlet des Iles. M. Charles Brindeau, ce directeur, avait ou? parler du talent de la jolie chanteuse et la fit reine du Châlet des Iles.
Dans son feuilleton des Débats, Jules Janin, le grand maître ès-critiques, salua la jolie scène qu'on ouvrait aux délicats Parisiens, et aussi l'aurore de l'étoile éclatante qui en faisait les délices. Citer un maître, c'est consacrer. La parole est à Jules Janin :
"Même à l'heure où chantait le rossignol, tout occupé ce soir des soins de la douce couvée, le Parisien demandait des chanteurs de théâtre." Il en demande au hêtre à feuilles de fougère; il en demanderait au saphora pleureur.
Des chansons ! des chansons ! c'est le cri universel.
Obéissons au Parisien, et véritablement dans cette île enchantée on a construit pour lui plaire un beau théâtre, et ce théâtre était à peine construit, que déjà poètes et musiciens étaient trouvés.
? Même une éclatante chanteuse, elle a nom M"? Chrétienno un nom rare au théâtre, si la chose n'est pas commune ? s'est emparée en Malibran de l'été de ce théâtre à peine ouvert, et,
d'une voix délibérée, elle jette à ces vieux arbres, qui semblent l'écouter en retenant le bruit de leur douce haleine, les plus belles fusées d'une voix de "vingt ans."
Mlle Chrétienno brillait désormais au firmament lyrique, parmi les plus goûtées de nos virtuoses.
En quittant sa cage, la Fauvette des Iles s'envola au théâtre Déjazet.Mais cette petite scène n'était point son rêve.
Chanter ! chanter ! était tout son bonheur. Et crut-elle mieux faire en entrant au Palais-Royal.
Le Palais-Royal non plus n'était point un théâtre d'opérettes.
En vain les auteurs firent-ils, pour utiliser cette voix jeune et souple, ample, magnifique, de char-mantes compositions : Danaê et sa bonne, Follambo, Un Ténor pour tout faire, etc., etc.
Les flonflons de vaudeville n'étaient point le fait de l'artiste, de sorte que le Palais-Royal lais-sait trop souvent sa chanteuse inoccupée. Celle-ci s'en plaignit. L'engagement fut résilié.
III
Mlle Chrétienno entra aussitôt au café-concert, en 1864.
L'Eldorado en eut la primeur. L'éclat de cette voix puissante captiva le public. Elle se créa
promptement un genre et un répertoire. Son début fut un triomphe.
Une cruelle maladie, qui la tint onze mois éloignée de la scène de ses succés, fit craindre un instant pour sa voix et même pour ses jours. Mais heureusement que sa jeunesse et les soins triomphèrent du mal; et sa rentrée fut saluée avec un enthousiasme facile à comprendre.
L'Alcazar, jaloux de la posséder à son tour, lui fit des offres magnifiques en 1867. Elle agréa.
Au mois d'avril 1868, elle revint à l'Eldorado, qu'elle n'a plus quitté. Le succès y attendait encore la chanteuse aimée.
Ses créations sont des trophées. Cependant ne citerons-nous que les principales. Parmi : la Batelière, Ay Chiquita, J'tapons dru, Mousqueton la Vivandière ; la tyrolienne des Perruques, tirée de la pièce de ce nom; la jolie Berceuse, de 'M. Montaubry, dans la pièce de M. Savard ; la Tribu des ongles roses, et tout récemment Ma Gazelle, que le public bisse chaque soir encore.
Pendant le cours de son engagement, les plus séduisantes propositions lui ont été faites. M. Ba. gier lui a ouvert les portes des Italiens; M. Perrin, le directeur de l'Opéra, l'a sollicitée. Il n'est point jusqu'à nos voisins d'outre-Manche qui ne nous l'enviaient. M. Frédérick Gye, directeur de l'Opéra royal italien de Covent-Garden, à Londres, lui a
offert le chiffre fabuleux de 2.500 francs par mois.
Elle a tout refusé.
Chrétienno est une artiste parfaite à tous égards.
Elle posséda une voix de mezzo soprano admirable. Son organe est régulier, vibrant, accentué; elle a comme des notes métalliques dans la poitrine qui savent résonner harmonieusement à l'oreille de ses auditeurs.
Artiste sympathique, chanteuse distinguée et fine comédienne, voilà sa dot. Il n'en faut pas da-vantage pour être parfaite.
JUDIC
I
Imaginez-vous ? dans le département de la Côte-d'Or ? un rocher pittoresque, baigné de trois côtés par l'Armançon; et là, flanqué au milieu de la mousse et de l'herbe, un joli petit nid qu'on appellerait la ville de Semur. C'est là qu'est née Anna Damiens.
Mme Judic devait naître dans un nid.
Anna Damiens est née le 18 juillet 1849.
Sa mère, Mme Damiens, était la nièce de M. Montigny, le directeur du Gymnase. En 1855, il donna à celle-ci, de préférence à une étrangère, le bureau de location du théâtre.
Anna, alors âgée de six ans, grandit dans ce milieu artistique, et acquit en croissant l'amour de la scène. ?levée pour ainsi dire dans les coulisses, adorée des comédiens et des comédiennes du boulevard Bonne-Nouvelle, comblée par tous de câlineries et de bonbons,.elle devait facilement s'éprendre d'un monde qui lui faisait goûter la vie en rose. "Je veux jouer aussi la comédie, " disait-elle dans son charmant langage enfantin.
Mais, comme dit le proverbe : qui a vu le loup, craint le loup;Aussi parents et amis firent-ils des pieds et des mains pour la détourner de ces perfides aspirations.
On lui fit faire son apprentissage dans la lingerie, croyant par là dissiper ces rêves de gloire qui enivrent souvent la jeunesse au point de la dévoyer.
D'ailleurs, il est fatal qu'élevé dans ce milieu artiste où vécut Anna Damiens, on n'y puise pas un amour irrésistible, un entraînement violent pour cette carrière si fascinatrice qu'on appelle : le théâtre.
Voyant l'inutilité des efforts faits pour l'en détourner, M. Montigny prit alors la résolution de l'y faire entrer, et de l'encourager même dans cette nouvelle partie, afin d'en faire le meilleur sujet.
Elle entra au Conservatoire à quinze ans. Là, elle fit ses études dramatiques et en sortit au bout d'un an pour débuter au Gymnase.
Dans son passage sur cette scène, Mlle Damiens ne fut pas remarquée, vu l'insuffisance de ses rôles. En outre, son extrême jeunesse, seize ans, et ses aptitudes physiques la condamnaient à l'emploi d'ingénue, ? mais la quintessence des ingénues.
Elle demeura pensionnaire du Gymnase pendant seize mois. Elle y avait joué dans les Grandes Demoiselles, le Wagon des Dames, les Erreurs du bel âge et autres rôles de fillettes. Faisant partie de la troupe ambulante, elle alla jouer à Compiègne, Soissons, Arras, etc. Tout semblait conspirer pour empêcher son talent de percer. Ainsi son mérite fut-il ignoré au théâtre.
Elle se maria le 27 avril 1867 à M. Judic ; et ce ne fut qu'après, que le café?concert la vit briller d'une façon si remarquable.
Après son mariage, elle vint à perdre sa mère; elle resta pendant un an encore chez son oncle. Ce n'est que du 1er septembre 1868 que date son engagement à l'Eldorado. Mais elle a su marquer sa place dès son début.
D'ailleurs sa vie d'artiste dramatique n'offre aucune particularité bien saillante. Et c'est simplement au café-concert, où elle a créé un genre et où elle est née ?toile, que nous voulons l'apprécier.
II
Jusque-là, le café-concert avait toujours semblé l'autel consacré, où le gros sel et l'excentricité immolaient au public. On eût dit que café-concert voulait signifier divertissement vulgaire. Et Mme Judic a confirmé une fois de plus que la grâce
et le distingué y pouvaient légitimement revendiquer une place.
Avant elle, on subissait presque l'emploi de la bluette, qu'on peut, peut-être, rapprocher de son genre, comme style, mais sans jamais atteindre le degré de délicatesse, de ténuité et de perfection na?ves que celle-ci a apporté à son rôle. C'est la quintessence de ce qu'il y a de plus tendre et de plus touchant ; elle s'est faite l'incarnation du mignon.
Il faut l'entendre dire, dans la Première feuille, avec cette mignardise et cet enfantillage adorables dont seule elle a le secret :
Enfin le soleil qui brille,
Ayant couvé mon bourgeon,
Vient de briser ma coquille ;
Je mets le nez au balcon.
O bon air ! ô douces brises !
Beaux papillons, hé ! là-bas !...
Venez dire des bêtises...
Ne me connaissez-vous pas !
Je suis la première feuille,
Qui avec bonheur on accueille,
Bonjour... bonjour... Espoir, amour,
Sont les dons que je recueille.
Je suis la première feuille...
Bonjour !... bonjour !...
Aussi ne lui marchande-t-on pas le succès, les bravos, les rappels, les bis, les ter ! De toutes ses interprétations elle a fait une œuvre, un morceau marquant.
Chez cette douce interprète des riens, qu'on a justement comparée à la sensitive, la moindre de ces petites choses, qu'elle seule peut toucher et qu'elle seule peut rendre, acquiert un cachet, une essence originale qu'aucune description ne sau-rait exprimer. Je crois qu'elle dirait le soupir d'une fleur.
Je n'essaierai point de vous tracer un portrait de cette mignonne artiste. L'attrait des femmes de théâtre est vif et mordant, en général. L'art crée, dans ce milieu factice une sorte de resplen-dissement artificiel, et inonde celles-ci de quelque chose comme un reflet idéal, ou divin, ou diabolique. Mme Judic n'est point auréolée de cette supercherie éphémère, qui tombe dans la coulisse. Elle est délicate et toute mignonne, comme la mélodie qU'elle gazouille. Un charme ensorcelant s'échappe de ses lèvres quand elle dit.

Tenez-vous au portrait ? ? Figurez-vous un médaillon de Boucher peint par Raphaël.
LAFOURCADE
Marie Lafourcade est assurément une étoile, et doublement : et par le talent et par l'originalité.
Aujourd'hui, où le type semble s'éteindre, où les personnalités disparaissent, on doit compter ces élus de l'Art, à qui ce don précieux n'a point été refusé.
Mlle Lafourcade a marqué sa place au Café-concert, en le dotant d'un genre qui lui est personnel; c'est une Thérésa de bon aloi et de bon goût, et la chose est appréciable, assurément.
Sa carrière est encore peu fournie, vu sa jeunesse; mais elle a débuté par un coup de maitre.
Elle naquit à Bordeaux, le 28 février 1848 ; ses parents vinrent s'établir à Paris en 1854.
Elle passa sa jeunesse partie en pension, partie au foyer paternel où elle s'occupait, en ménagère précoce, des soins de la maison, allégeant sa mère dans ses travaux.
Elle commença de bonne heure la carrière lyrique pour laquelle elle se sentait une vive inclination. Douée ,d'ailleurs d'un organe remarquable, elle chantait du matin au soir de joyeux flonflons.
Elle entrait, à quinze ans, comme choriste aux Bouffes, qui comptaient déjà ses deux sœurs, Mathilde et Louise.
Elle y resta trois années, pendant lesquelles elle n'en sortit que pour aller chanter au Châtelet, dans le Déluge.
Ses débuts au concert datent de 1865. Ce fut à Bruxelles, à la salle du Grand-Orient, qu'elle débuta, par un engagement de trois mois.
Elle revint à Paris, en représentation, dans les établissements de second ordre, il est vrai, mais où elle commença à se faire connaître.
La province l'accapara : l'Eldorado de Rouen, le Casino de Marseille, l'Alcazar de Bordeaux et l'Eldorado de Lyon [*] la possédèrent tour à tour. Nommer ces quatre villes est assez dire combien son talent était déjà apprécié.
Elle ne tarda pas à venir se fixer à Paris.
En 1867, au mois de mars, l'Eldorado l'engagea et le succès qu'elle y a obtenu a affermi sa répu-taq.ion. Elle est passée étoile d'emblée.
Marie Lafourcade a doté le Café-concert d'un nouveau genre. Cette innovation louable a fait réaction contre le débraillé de Thérésa. C'est un progrès; c'est donc un mérite.
Les principales créations de cette artiste ont
été le Pifferaro qu'elle a chanté pendant trois mois consécutifs, sans lasser ses dilettanti ; le Rat Crevé, un heureux type ; la Rigolade, la Noce parisienne, J'n'avons point d'esprit, Faut avaler ça, les Plaintes d'Adèle, etc.
Elle est en outre supérieure dans la saynète : Paola et Pietro, représentée soixante-douze fois de suite en est la preuve. D'ailleurs comme interprètes, Piétro (Lafourcade) et
Paola (Judic), étaient du meilleur choix; et les auteurs, MM. Bedeau et Paul Henrion, auront difficulté à trouver une nouvelle création pour ces deux privilégiées de l'Eldorado.
Mlle Lafourcade dispose de quatre mois de congé pendant la saison d'été. En 1867, elle les a passés à Saint-Pétersbourg, à l'établissement si renommé des Eaux-Minérales. Ses directeurs, MM. Isler et Decker-Schenck, nous enlèvent tous les ans nos meilleures étoiles et les dotent de féeriques appointements.
L'été dernier, Mlle Lafourcade a été victime d'une supercherie de la dernière indignité.
Un soi-disant directeur de Vienne (Autriche), vint l'engager aux appointements irrésistibles de 3,000 francs par mois.
Voici, du reste, sous la signature de M. Jules Prével, ce qu'en disait le Figaro à l'époque.
" Il ne fait pas toujours bon voyager, pour les artistes du moins.
Mlle Lafourcade, qui a eu de beaux succès dans les cafés-concerts de Paris, reçut l'hiver dernier la visite d'un monsieur se disant le directeur du premier établissement lyrique de Vienne (Autriche).
Ce monsieur faisait des conditions splendides à la chanteuse, mettant à sa disposition toutes les avances d'argent possibles, et assurant que son établissement était le premier de la ville.
Mlle Lafourcade accepta et partit.
Arrivée à Vienne, grand fut son étonnement de voir ce concert dans un des quartiers les plus reculés de la ville et d'y avoir pour tout auditoire un public répugnant.
Elle s'informa immédiatement auprès de son hôtelier, qui lui apprit que le concert en question était une sorte de maison interlope, fréquentée par les repris de justice, les vagabonds, les demoiselles, et était sous la surveillance de la haute police.
Comme bien vous pensez, la chanteuse eut peur, et voulut résilier à tout prix.
Le directeur refusa énergiquement et lui fit même les menaces les plus violentes.
Sans l'énergique intervention de notre consul, Mlle Lafourcade n'aurait jamais pu en sortir.
Je crois même qu'il fallut l'aide de la police pour ravoir ses costumes"
Mlle Lafourcade a acquis parmi nos célébrités une place dont il serait injuste de contester la légitimité.
Bonne chanteuse et bonne comédienne, elle a une voix étendue et bien timbrée, vibrante, qui sonne juste à l'oreille du public. Elle joint à cela une certaine crânerie d'allures qui lui sied parfaitement. Cascadeuse sans être impertinente, délurée sans forfanterie et sans affectation, elle est la personnification de la gaie chanson ; son jeu n'est point étudié, ses gestes ne sont point maniérés, sa diction est éloquente et expressive.
Marie Lafourcade, a vingt et un ans, n'est point arrivée à l'apogée de son talent ni de son succès.
Tout fait présager en elle pour l'avenir une étoile éclatante.
VIGNEAU
Il y a des artistes qui, sans être consacrés étoiles par la déesse Vogue, ont cependant un talent réel. Quoique ne figurant qu'au second plan, ils n'en possèdent pas moins des qualités d'élite et sont susceptibles de briller un jour au premier.
Mlle Vigneau n'occupe peut-être pas le rang que son mérite commanderait , car son mérite est grand.
Fille d'artiste, artiste dès le berceau pour ainsi dire, élevée sur les genoux des artistes, elle 'est ce qu'on peut appeler un enfant de la balle.
Ses parents, attachés à une troupe dramatique qui exploitait l'Afrique , se trouvèrent un beau jour de l'année 1849 obligés de faire halte. C'était à Blidah. Et, quelques jours après, le 17 décembre, Mme Vigneau mettait au monde un bébé du sexe féminin auquel on donna le prénom de Virginie.
Au contraire des enfants qui poussent d'affreux vagissements, elle chanta en venant au monde.?C'était un symptôme évidemment.
Virginie promettait, comme vous voyez ; elle tint aussi.
En 1855, elle avait alors cinq ans, elle fit ses débuts d'artiste lyrique au Grand-Théâtre ,
à Nîmes. Débuts brillants, relativement à son âge; car on s'imagine de quelle affectueuse indulgence on pouvait user à l'égard de semblable interprète. Cependant, pour être juste, Virginie n'était point une enfant ordinaire : on la mettait au rang des prodiges. Du reste, la Gazette de Nîmes, en faisant un éloge analytique et assez modéré pour être digne de crédit, prouva que Virginie n'avait point été traitée en enfant, mais bien en artiste.
Elle alla ensuite au Casino de Marseille et au théâtre Chave de la même ville, où elle fit pendant plusieurs mois les délices des Marseillais.
Elle parcourait ainsi les villes les plus importantes du Midi, chantant son charmant et joyeux répertoire, qui se composait des morceaux alors en vogue et de scènes dialoguées en costumes.
Elle disait ainsi : le Tambour d'Arcole, l'Artiste, la Vengeance des Femmes, le Trompette de Marengo.
C'était avec l'air le plus décidé, bonnet de police gaillardement flanqué sur l'oreille, que le petit hussard vous disait :
Au petit trot, trot, trot, trot,
Puis au galop. . . . . .
En représentation au théâtre de Nice, pendant le séjour de la duchesse de Bade, celle-ci, émerveillée des récits qu'on lui faisait de ce petit prodige, voulut l'entendre et la fit venir pour donner une soirée dans ses salons.
Elle y fut admirée. Et la duchesse lui remit, avec une somme de 1,000 francs, un brevet sur lequel elle a manifesté son enthousiasme. C'est un témoignage sympathique d'une admiration de haut lieu, témoignage cher à l'artiste et qu'elle conserve religieusement.
Après avoir parcouru Lyon, Bordeaux, après être retournée grand nombre de fois à Nîmes, où elle était littéralement adorée, l'enfant devenue jeune fille affronta d'emblée la rampe de l'Alcazar, au mois d'octobre 1868.
Elle s'y est fait une réputation des meilleures parmi les comiques de genre, en créant les Canards, Auguste, la Marchande du Temple, J'aime ces amours-là, ?a vaut toujours mieux que rien, et d'autres créations dont le souvenir m'échappe.
Depuis trois mois à l'Eldorado , du 1er octobre 1869, elle a grandi encore en abordant une scène supérieure, le premier des cafés-concerts. Et dans un si court espace de temps, elle a fait encore un grand nombre de nouvelles créations. Parmi, je citerai : la Couturière, Faut prendre les hommes par la douceur, les Plumes, la Gauloise, la Poudre aux yeux, qui toutes ont obtenu un grand et légitime succès et confirmé un talent qui ne peut manquer de croître encore.
Mlle Vigneau a vingt ans ; elle est jeune. Elle a l'avenir devant elle; et l'avenir, c'est l'espérance.
KAISER
Il serait inexact de ne pas faire figurer ici la biographie de Mlle Kaïser, car c'est l'Eldorado qui a consacré sa renommée, qui l'a faite Mlle Kaïser.
Avant d'arriver à Paris, elle avait parcouru la province. Avignon, Montpellier, Marseille, Toulon, Saint-Etienne, Lyon, l'avaient écoutée sans la remarquer.
Il serait cependant injuste de lui refuser le don de la voix. Sous ce rapport, Mlle Kaïser est admirablement douée ; son organe est pur, sonore, étendu et juste. Il lui manque peut-être le jeu, qualité assez rare chez nos jeunes chanteuses, et qui ne s'acquiert qu'à la longue.
Du 1" octobre 1867 -- au 30 septembre 1869.
Ainsi peut se résumer la carrière brillante de Mlle Kaïser. C'est-à-dire la période de son passage sur la scène de l'Eldorado.
Le succès qu'elle y obtint ne fut point, il est vrai, l'enthousiasme. On l'y applaudit, on l'applaudit même beaucoup. C'était un bon sujet.
N'étant point née artiste, il ne doit pas sembler étonnant que Mlle Kaïser éprouve quelque
difficulté dans le jeu scénique. C'est ce qui arrive à la plupart de nos chanteurs et de nos chanteuses qui abordent subitement le café-concert. On ne se fait pas virtuose, comme on se ferait marchand de musique. Et, dans les carrières artistiques, cet instinct qu'on appelle la vocation est presque toujours une des conditions du talent.
Bien chanter ne suffit pas; il faut aussi bien dire et bien rendre l'impression qu'on a mission de communiquer à son auditoire. Mlle
Kaïser apprend ; elle ne crée pas. Et c'est ce défaut qui empêchera peut-être cette artiste de briller sur une nouvelle estrade, où chaque fois sera pour elle un début en quelque sorte. De sorte que, dépaysée ce qu'on appelle, la carrière qu'elle ouvrit si heureusement à l'Eldorado, où l'on était habitué à l'applaudir, est à recommencer entièrement sur une autre scène. Et c'est scabreux.
Je sais que a "noblesse oblige". Si le proverbe peut servir de passe-port à Mlle Kaïser , tant mieux.
ZÉLIA
Cette artiste a été choisie pour succéder à la précédente.
Disons. tout de suite les avantages qui la distinguent.
Quoique plus neuve au concert, elle possède d'éminentes qualités. Si elle a la voix moins forte, elle ne manque pas cependant ni d'accentuation ni de limpidité ; elle est suave sans être vibrante. Mlle Zélia a en outre de la distinction et de l'initiative ; ce qu'elle chante, elle le dit avec goût, elle le module avec harmonie, intelligemment. Elle ne se croit pas étoile, et c'est peut-être une qualité. ? Elle sait lire et écrire.
Mlle Zélia Amiscel est née à Port-Louis (Morbihan), le 8 octobre 1844.
On peut dire qu'elle débute dans la carrière artistique, car son premier engagement date de 1868, à Nantes. Mais Nantes l'a appréciée.
Elle n'est à l'Eldorado que depuis le 18 septembre 1869. Et l'accueil du public lui a déjà prouvé qu'elle était la bien venue.
Sans prétendre nous flatter de prédestination, il nous sera permis d'affirmer qu'assurément Mlle Zélia sera une étoile un jour.
Pourquoi ? -- Voici :
C'est que Mlle Zélia apporte un talent réel; l'étude et l'expérience seules lui manquent.
Son sort est donc un peu entre ses mains.,
JULIA
Celui ou celle qui arrive à figurer sur la première scène de Paris, est incontestablement un artiste de mérite. Le baptême de l'Eldorado est une consécration.
Mlle Julia Boulay est née à Rouen le 19 janvier 1849.
Son bagage artistique est léger encore. Toute jeune et débutante au concert , son dossier ne saurait être volumineux. On ne peut à présent que constater un talent naissant, et que bien en augurer pour l'avenir.
Au contraire de la cigale de la Fable, Mlle Julia avait commencé par danser. Il y a un an, elle était un Rat du corps de ballet à la Galté. Elle chante maintenant.
Douée d'un organe agréable , elle préféra les lauriers du chant à ceux de la chorégraphie. Et Terpsichore fut délaissée.
Mlle Julia débuta au concert des Ambassadeurs, aux Champs-Elysées, l'été dernier; et vint ensuite à l'Eldorado, le 7 octobre.
Comme ce livre, en somme', n'est point une apologie de parti pris, je ne louerai pas à tort et à travers tout artiste dont il est fait mention. Voilà
pourquoi je ne vanterai pas par-dessus les toits "la voix et le talent incomparables de Mlle Julia". Je la féliciterai dans son modeste rôle, et lui dirai crûment, en qualité de débutante : Travaillez, pour conquérir le titre d'Etoile.
RENARD
I
Grandeur et décadence !
Telle semblerait être l'épigraphe qu'on doive placer en tête de cette biographie.
Certes, après avoir joué le plus grand rôle, après avoir dégusté tous les enivrements de la gloire, il est amer pour une illustration telle que Renard de se voir plongé dans l'oubli, lui qui fut le premier ténor du monde.?Il est non moins triste, pour la génération spectatrice, d'avoir à déplorer une perte semblable , que de longtemps on ne réparera pas au théâtre.
Le rôle de Renard n'en est pas amoindri pour cela. Sa page de gloire est inscrite et ineffa?able.
Antoine Renard est né à Lille, le 15 février 1825, d'honnêtes artisans.
Son père, menuisier de son état, rêvant peu la gloire, subissait courageusement le Sort qui ne l'avait point fait millionnaire, et, laborieux ouvrier, avait grand souci d'élever du mieux possible sa famille.
Les premières années du marmot se passèrent sans incidents, et rien, dans les criailleries enfantines de son âge, ne révélait le futur ténor. Il ne fut point prédestiné.
Antoine apprit le métier de son père, ne pouvant trouver meilleur professeur.
Puis un jour, il avait alors seize ans, la Mort qui lui avait déjà ravi sa mère, lui enleva encore sa dernière affection.
Paris l'attristait désormais, Paris où tout lui parlait de son père qu'il adorait. Et, un beau matin, le sac au dos, le bâton ferré à la main, il partit pour faire son tour de France.
Il voyagea ainsi trois ou quatre ans, chantant et jouant la comédie dans les théâtres d'amateurs que les ouvriers montent souvent en province.
La Révolution de 1848 arriva, les ateliers fermèrent, et voilà notre ami Antoine sur, le pavé.
Pendant les cinq ou six mois de chômage qui suivirent la Révolution, Renard prenant coura-geusement son parti, prit une guitare et alla chanter de rue en rue et de cour en cour. Et les sous tombaient dru comme grêle des plus hautes mansardes.
Ce résultat inattendu lui donna du courage, et il s'en fut tout droit au Conservatoire. On le re-fusa net. Un des professeurs poussa même la sin-cérité jusqu'à lui dire qu'il était bon tout au plus à faire un choriste.
Il fut alors introduit chez M. Bizot, un agent-
professeur qui, après l'avoir entendu chanter un morceau, émerveillé, lui donna, séance tenante, une lettre pour Dietsch, le chef de chant de l'Opéra.
Renard, tout enthousiasmé, court comme une flèche à la rue Le Pelletier.
On l'introduit; . il chante de nouveau. Dietsch ravi, à l'exemple de Bizot, court au cabinet de la direction, enfonce la porte, et revient bientôt amenant de force M. Roqueplan, alors directeur, pour lui faire entendre cette voix exceptionnelle. Roqueplan, en homme de goût et d'esprit, engagea sur-le-champ comme choriste le pauvre chanteur tout abasourdi de son succès et se chargea de son éducation musicale.
M. Roqueplan s'applaudissait de plus en plus de sa nouvelle recrue , et préparait déjà les débuts du nouveau ténor, dans le rôle, modeste, du Chevalier, qui chante au troisième acte quel-ques phrases anodines dans la Reine de Chypre. Renard, non moins enchanté que son directeur, courut vite chez son professeur pour lui apprendre cette bonne nouvelle. ? Mais Révial [*] n'en fut point satisfait du tout, et se fàcha même tout rouge, ne voulant que sous aucun prétexte Renard acceptât un si piètre emploi pour son talent.
ll fallait choisir entre le professeur et l'Opéra:
Ce fut le cœur gros, bien gros, mais par
reconnaissance, qu'il embrassa le parti du professeur. Tout était rompu avec l'Opéra. Et ce n'est pas sans verser d'abondantes larmes qu'il vit s'anéantir tout cet échafaudage d'illusions et d'espérances qu'il s'était plu à concevoir.
Quelques temps après, à la suite d'une vive dis-cussion, Révial abandonna son élève, malgré les promesses qu'il lui avait faites de le pousser et en dépit de l'attachement que Renard lui manifestait et dont il lui avait donné preuve.
Voilà donc encore une fois le malheureux Antoine sur le pavé de Paris, sans argent, en quête bien souvent du dîner du jour et du déjeuner du lendemain.
[*] Note des Auteurs : Marie Pauline Françoise Louis Benoît Alphonse Révial né le 29 mai 1810 à Toulouse (31 - Haute-Garonne) et décédé le 14 octobre 1871 à Paris 9e. Au Conservatoire de Paris, il obtient le second prix de chant au concours de 1831 puis le premier prix en 1832 .En 1843, de retour de Varese (Italie) et La Haye (Pays-Bas) où il a été premier ténor, il passe à l'enseignement. Trois années plus tard, il est professeur de chant au Conservatoire de Paris.Il fut aussi le professeur de Marie Cico.
II
A cette époque, le Palais-Royal était le rendez-vous habituel des acteurs et des directeurs de théâtre. Là, souvent ceux-là y rencontraient un engagement; ceux-ci y composaient aussi leurs troupes; et l'un et l'autre se passaient parfaite-ment de l'intermédiaire du correspondant, dont les honoraires sont toujours un pesant impôt pour l'artiste.
Renard s'y rendit. Ce fut-là qu'il la ren-
contre de M. Marius Chabot, qui avait la direc
tion de Nîmes et cherchait un ténor. On entra en
pourparlers ; bref, l'engagement fut arrêté aux
conditions de 500 francs par mois, et les débuts
furent fixés au 23 septembre. Nous étions en 1852.
Son succès y fut des plus grands ; mais le directeur vint à faire faillite, et Renard à son grand regret quitta Nîmes, le cœur plein de reconnaissance pour le public chaleureux qui l'avait tant acclamé, encouragé ses premiers pas dans la carrière si difficultueuse qu'il allait désormais parcourir en lévite ardent.
Le directeur du théâtre du Hâvre eut vent de cette jeune réputation et se l'appropria à son tour, pour la saison d'été, car Renard avait déjà son engagement pour la campagne suivante. Les quatre mois de mai, juin, juillet et août qu'il passa au Hâvre, furent pour lui un nouveau couronnement. Dans cette ville manufacturière et ouvrière, son succès y fut surtout populaire. Son histoire était déjà connue, et les ouvriers des usines se ruaient comme une avalanche à ses représentations, fiers d'applaudir un des leurs, un enfant de l'atelier comme eux. Renard, du reste, fut et est toujours resté simple et bon.
Les Hâvrais lui offrirent, à son départ, en souvenir, une magnifique épée, style Renaissance, celle qu'il a toujours portée depuis à chaque re-présentation des Huguenots.
De là, il remplit son engagement à Strasbourg. M. Halanzier, le directeur, l'avait pris pour tenir
l'emploi de premier ténor, aux appointements de 1,200 francs par mois, à la charge de chanter six fois seulement; chaque représentation en sus lui était payée 300 francs.
Là, comme à Nîmes, comme au Hâvre, même succès. Les ovations ne lui faisaient pas faute, et les articles les plus enthousiastes venaient le récompenser des pénibles tâtonnements du début.
En 1854, il fut engagé à Bordeaux, aux appointements de 2,000 francs. Il était enfin arrivé.
Paris ne se décidait pas encore; et Lyon, en ville intelligente, l'accapara pour deux ans, au chiffre raisonnable de 2,500 francs la première année et 3,000 la seconde. Son succès y fut plus grand encore qu'au Hâvre et à Strasbourg.
Rappels, bouquets, ovations, rien ne manqua au triomphe de l'artiste pendant les deux années qu'il passa dans la cité lyonnaise. Lui, de son côté, ne fut pas en reste de reconnaissance ; il montra qu'il était digne non-seulement des applaudissements, mais encore de l'estime qu'on lui prodiguait. Concerts, représentations à bénéfice, fêtes de charité, il saisit toutes les occasions de prouver que chez lui l'homme était à la hauteur de l'artiste, et que sa générosité égalait son talent.
III
Enfin Paris vit briller ce talent incomparable. Il débuta presque au pied levé dans la Juive. Et le succès qu'il remporta le fit engager immédiatement par M. Alphonse Royer.
Méconnu d'abord, il se trouvait alors abreuvé à la fois par la gloire et la fortune. Tout le monde sait le reste.

Renard, le roi des ténors , au comble de la gloire, à l'apogée de la réputation, se vit un jour, par une maladie cruelle autant que désastreuse, privé de sa voix. C'était à Marseille.
A Paris, chacun interrogeait anxieusement les bulletins venant de cette ville, pour savoir des nouvelles du ténor aimé. Chacun redoutait pour l'avenir l'infériorité, peut-être le néant !
Grâce aux soins et à la science du docteur Laboulbène, sa voix revint cependant; non pure comme autrefois, mais encore belle dans son échec.
Après sa convalescence, ce fut à Bruxelles, au Théâtre-Royal de la Monnaie, qu'il se fit entendre.
On redoutait cette épreuve et, disons-le tout de suite, les appréhensions bien légitimes dont était inspiré le public ne furent heureusement point
justifiées. Les ovations bruyantes, les rappels enthousiastes, les honneurs du triomphe enfin, attendaient celui dont on avait craint un instant d'avoir à déplorer la ruine irréparable.
Si Renard n'avait pas retrouvé, complétement peut-être, cette voix ample et sonore, magnifiquement timbrée, qui, durant plusieurs années a excité l'admiration sur le premier théâtre lyrique du monde, il était en état de défier encore la plupart des célébrités du moment.
Il se maintint ainsi quelques années.
Mais hélas ! cette résurrection inespérée n'était qu'éphémère, et depuis ce temps date la décadence de Renard.
Bientôt la dépréciation, si facile à accourir, fit le vide autour de lui. Renard, le grand Renard, ne trouvait plus d'engagement.
Il revint à Paris.
L'Eldorado lui fit des offres brillantes.
Il accepta. C'était en 1864.
Le ténor resta deux ans pensionnaire de M. Lorge; en compagnie de Suzanne Lagier et de Chrétienno. Là il n'avait pas dérogé.
Mais sa voix baissait sensiblement. Il prit sa retraite.
Sa carrière était à jamais brisée.
Saurait-on infliger un blâme au ténor, malheureux le premier, de la catastrophe dont il est la victime ? -- Non ; car ceux qui connaissent Renard savent tous quel cœur généreux et suprêmement bon il est.
Cette adresse en est une preuve.
"A Monsieur Renard , ex-premier sujet de l'Académie impériale de musique , les ouvriers (choristes) du faubourg Saint-Antoine et du Marais.
"O toi qu'un bon génie n'a pas craint d'arracher un jour de l'humble atelier du prolétaire, pour t'introniser comme un des premiers ténors, sur la première scène lyrique de la France, re?ois, en ce jour, nos remerciements d'avoir bien voulu dernièrement penser à nous autres, enfants du peuple, à nous pauvres ouvriers et artisans; oui, merci à toi de n'avoir pas dédaigné, avant de quitter la capitale, venir un beau soir sur cette humble scène du faubourg Saint-Antoine, nous faire entendre dans Madeline, dans No?l, et dans la Juive les accents pathétiques et mélodieux de ta voix ?
"Renard, si les grands théâtres ont résolu de t'oublier, nos cœurs à nous, crois-le bien, ne t'oublieront jamais ; non, jamais. Le peuple, tu le sais, n'est point ingrat ; viens encore à lui, et il viendra encore à toi.
"En attendant, crois-nous pour la vie tes sincères et dévoués admirateurs.
"Au nom de ses camarades de diverses sociétés chorales, présents à cette solennité musicale et théâtrale.
" Signé : A. Fichot, rue Saint?Antoine, 149."

Il y a quelque chose qui dépasse le niveau des afflictions communes dans cet écoulement subit des royautés de la scène, et l'on ne peut voir sans une compassion respectueuse, ces brillants favoris de la foule, dépouillés en un clin d'œil de ce qui constituait leur prestige, descendre avant Plieur? de ces sommets glorieux où l'on ne monte qu'à force d'intelligence et de travail. Heureux ceux qui ont eu le temps de sauver leur nom de l'oubli et que les fatalités de la vie n'enchaînent pas après la chute dans les réduits obscurs du paradis perdu !
Durant toute sa vie, Renard ne sut que faire le bien et rendre service à tous. Les seuls sentiments qui doivent animer chacun aujourd'hui sont la reconnaissance et l'admiration. Mais l'esprit fron-deur et égoïste du siècle fait que l'on jette facilement le blâme sur les vaincus, et, sans s'inquiéter du passé, on ausculte le présent, quand on ne prévise pas sur l'avenir.
Le plaindre, certes, ne le guérit pas et ne réparera pas non plus une semblable perte. Mais pourquoi, l'oubli ? ? Une marque de sympathie
fait tant de plaisir et soulage tant un cœur affectueux et sensible!- ? Et je vous promets que Renard n'est point un indifférent.
PACRA
I
S'il en est ,un parmi nos chanteurs qui mérite une couronne, c'est sans conteste M. Pacra. Il est. sans rivalité, le "roi de la Chanson."
La chanson que chante M. Pacra n'est point cette pasquinade basée sur l'ineptie , ce couplet grossier qui sent mauvais, ni de ces conceptions ordurières , façon Trois - Etoiles et Cie; mais bien la belle et bonne chansonnette , de bon goût, spirituelle et gauloise, celle des Béranger et des Désaugiers du jour, ? Béranger et Désaugiers un peu déchus, il est vrai, mais au moins poètes conservant le respect d'eux-mêmes.
Et, par le temps qui court, chanteurs sont aussi rares que chansonniers. Aujourd'hui , où nous avons tant de diversité, tant de raffinement dans nos jouissances sensuelles , la sévère tradition s'en va, le vieux a fait son temps. ? Les comiques excentriques, les tyroliens , les clowns, les clodoches ? pour le sexe masculin?; les danseuses et les Saqui ?pour le féminin ?, tout ce monde-là n'a-t-il point envahi le domaine de la chanson ? Leurs exhibitions lascives ne chatouillent-elles pas mieux les sens qu'un prosaïque monsieur en habit
noir, qui vient nous débiter gravement de bons vers, ma foi, mais qui ont le défaut de rimer, d'être en mesure et d'avoir du sens ?
Ne trouvez-vous pas comme c'est fade, ce rire d'intelligence, cet épanouissement de l'esprit ? Et ne vaut-il pas mieux cet accès éclatant de la lubricité sensibilisée, sinon satisfaite ?
Les promesses affriolantes d'un programme plein de sensualité, le raffinement de la nudité, ont bien plus de charmes que ces contés drôles et égayants, il est vrai, mais trop chastes pour un temps qui ne l'est pas du tout. Ne sont-elles pas plus agréables ces impressions qui viennent sourire au dévergondage de la pensée et exciter le chatouillement brutal des sens, que ces prudes souvenirs que vous laissent la chanson, la vraie chanson ?
Et, que diable ! messieurs, soyons de notre siècle.
Malgré cela, M. Pacra a perpétué le rôle de la chanson, de la bonne chanson d'autrefois.
Il l'a fait en dépit de tout. Et il a bien fait.
Mais il a fallu tout son talent, tout son goût, tout son esprit, toute cette science, en un mot, dont seul, entre tous, il a le secret pour se faire digérer. Au dix-neuvième siècle !
Disons qu'il a pleinement réussi, et que le succés compte au nombre de ses meilleurs amis.
II
Jules Pacra est Parisien ; c'est peut-être déjà une circonstance atténuante. Il est né le 26 mars 1833, au n° 4 du marché Sainte-Catherine.
Ses parents, dans une modeste position, ne lui firent pas faire de grandes études. Entré à six ans dans la pension Peignon, rue Jarente, il en sortit à treize, sachant lire et écrire, connaissant un peu la langue et les quatre règles. Le commerce du monde et l'amour-propre personnel firent le reste.
A treize ans, quoique ayant l'âge de raison, on est généralement peu fixé sur la profession qu'on doit suivre, et souvent ce sont les parents qui en décident au nom de l'intéressé. On mit Jules Pacra en apprentissage chez un sculpteur.
Sans ressentir de répulsion pour une partie, certes des plus belles, Jules ne professait pour la plastique et ses pompes qu'un enthousiasme très-
,
modéré. Ce dont on s'étonnait chez lui.
Enfant docile, surtout docile, il ne savait pas ce que c'était que contrarier un père, une mère.
D'ailleurs lui-même, sans savoir au juste ce qu'il voulait, sentait que là n'était pas sa voie. Et voilà tout.
Il travailla docilement pendant trois ans à la sculpture. Et il n'était point un héros.
Lui, ne s'étonna point du tout. Mais les parents, un peu dé?us sur le manque de splendeur d'une étoile qu'ils avaient fait briller dans leur imagination de père et de mère, constatèrent la désillusion. Et leur réveil fut une amère déception.
Jules Pacra avait vieilli , l'expérience qu'on acquiert chaque jour l'avait instruit, le raisonnement, sinon la raison, l'avait éclairé.
Sans avoir jamais vu une salle de spectacle, sans même se rendre compte de ce qu'on pouvait y faire, ne connaissant l'art dramatique que de nom, il éprouvait ce je ne sais quoi irrésistible, qu'on appelle la vocation, qui le poussait vers quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il rêvait les lauriers de la rampe.
Dans sa chambrette de bambin, il avait fait du lit une scène ; un drap était le rideau ; un manche à balai ? pardonnez-moi la vulgarité des détails, mais ils sont de la plus exacte vérité ? un manche à balai, dis-je, servait de support, et une corde, attachée à chaque bout, tirée par deux machinistes, l'agitait de bas en haut. Quoique primitif, ce n'en était pas moins ingénieux.
En outre, il y avait des affiches, de véritables affiches, que Jules calligraphiait lui-même avec le soin et l'agencement les plus scrupuleux, et qui donnaient le programme des pièces, la plupart du temps, monologues que le futur artiste devait improviser.
Ces représentations avaient lieu le dimanche, jour de congé, devant un public des plus indulgents, composé de son père et de sa mère, de quelques bons voisins, d'un camarade d'apprentis-sage et du fils de son patron. Ces deux derniers l'assistaient quelquefois de leur concours, et, il y a encore peu de temps, me contant le fait, me disait Pacra avec beaucoup de conviction : "Nous avions beaucoup de succès!!..."
Les parents, qui n'étaient point affectés du sot préjugé que certaine classe de la société a du théâtre, parce qu'on y châtie leurs vices et leur immoralité, entrevoyaient dans leur fils un grand acteur avec autant de plaisir qu'un grand sculpteur. Ils l'eussent aussi bien rêvé un grand diplomate ou un grand épicier.
On ne songea donc point à le détourner d'une carrière qui semblait être sa vocation.
Vinrent les événements de 1848. Les travaux cessèrent, et Pacra chercha un emploi lucratif. Il avait alors quinze ans.
Il entra au National, comme employé au bureau des abonnements et faisait quelques courses au besoin; il avait ses entrées à la rédaction, on le chargeait des missions discrètes. Il ,était, en un mot , ce qu'on appelle l'enfant de la maison.
Ses loisirs lui permettaient de fréquenter le théâtre assidûment, et point n'est besoin de vous dire qu'il ne s'en faisait pas faute.
En ce temps-la, Bouffe, Arnal, Lafont, Bressant , Bocage , jouissaient de leur grande re-nommée. Et la vue de ces Maitres ne fit qu'exciter en lui le désir nourrissait depuis longtemps de faire ses débuts pour de bon.
Ces gens-là pensait naïvement Pacra, ne sont
pas faits comme d'autres; ils ont la peau bien blanche , des couleurs bien roses , des coiffures bien regulières
I.....
Et it s'examinait, et it pleurait, désolé de ne point remplir les conditions qu'il croyait obliga-toires. "Je ne pourrai jamais être acteur !....."
Et it pleurait encore.
Cependant, a une représentation du Gamin de Paris, où Bouffé jouait, ayant exhalé tout haut son enthousiasme, un voisin complaisant, avec lequel it etait entré en conversation, lui apprit qu'il se mettait du rouge et du blanc, et lui dévoila les secrets du grimage. "Sauvé ! " s'écria Pacra. Et ii court encore.
Le lenflemain , it signait un engagement à 30 francs par mois au théâtre Montmartre.
III
Son premier rôle fut un portier de soixante-dix ans dans le Docteur Chiendent.
Un directeur de province qui se trouvait là, dit, en le désignant : "Voilà un homme qui connaît son affaire; je l'engagerais bien s'il n'était pas si vieux."
Pacra comptait dix-huit printemps.
De là, six mois après, il'partit pour Grenoble en qualité de jeune comique. Le public d'étudiants est généralement fort difficile, et les débuts sont une pierre d'achoppement, même pour les infiniment petits.
Pacra plut. 'Et on lui donna même le sobriquet fiatteur de petit chéri.
Etant à Grenoble, ses vingt-et-un ans sonnèrent, et Jules était au désespoir, car son père qui avait tiré au sort pour lui à Paris, avait amené un mauvais numéro.
Son frère, qui était sous les drapeaux, se dévoua pour lui, prit son temps de service pour lui permettre de continuer une carrière dans laquelle it promettait de devenir une célébrité.
Après avoir fait quelque peu la province, pendant treize mois consecutifs, it revint a Paris.
II trouva un engagement an théâtre Beaumarchais, et it signa le ler septembre 1854.
C'est la qu'il fit sa première création : Sidoine, dans le Paradis perdu. Ce fut pour lui un immense succès.
Il serait peut-titre oiseux de rapporter ici les comptes-rendus, tous élogieux,qui parurent aux feuilletons des lundistes, dans le Siècle, le Pays, le Moniteur universel, mais il ne me semble.pas cependant inutile de rendre des impressions signées Matharel de Fiennes, Edouard Thierry et Mery.
Voici ce qu'en disait Mery : "Il a du feu dans les yeux."
M. Edouard Thierry reconnaissait en lui : "Un comédien de bonne école."
Et M. Matharel de Fiennes affirmait que : " Pacra ferait un jour ses volontés dans un théâtre de genre, et exigerait du directeur 30.000 fr. d'appointements."
C'étaient de bons passe-ports pour l'avenir.
Aussi Pacra, encouragé et soutenu dans sa voie, redoubla d'energie et de volonté pour ar-river. Il arriva.
Quelque temps après, sur la recommandation de deux auteurs, MM. Saint-Ernest et Auguste Luchet, it entra au théâtre de la Gaité, puis plus tard a l'Ambigu, où it est resté deux années.
Dans cette dernière étape, il obtint beaucoup de succès dans Jacquin du Tuyau de poêle, Triptolème
du voyage du haut en bas, Anténor de Frère et Soeur, etc., etc.
Le ler avril 1857, Pacra joua, en représentation pendant un mois, Pierre le Couvreur, au theatre Beaumarchais.
IV
C'est à cette époque, qu'il quitta le théâtre.
Ce fut au café-concert du Géant, situé sur le boulevard du Temple, qu'il fit ses premières armes en matière d'art lyrique.
Le succès le suivit au concert comme au théâtre.
Il resta au Géant dix-huit mois, acclamé, fêté, aimé ; les acclamations étaient unanimes et en-thousiastes
Lyon voulut le posséder à son tour. Il y partit au mois de septembre 1857.
La, comme-ailleurs, it sut conquérir par son talent toutes les sympathies. Et Lyon, vous le savez, est l'écueil de bien des chanteurs, voire de nos meilleurs. Et Lyon ratifia le mérite réel de M. Pacra.
Pacra possède au premier degré l'art de se grimer. Dans une élégie touchante, le Dernier chant de Béranger, il avait tellement réussi, it faut dire aussi que son physique y prête beaucoup, a imiter
la tête de notre poète national, qu'un ami de Béranger lui adressa quelques vers improvisés sous le charme de rinterprétation.
Après un engagement de sept mois et demi à. Lyon, Pacra revint à Paris.
Les portes du Géant s'ouvrirent toutes grandes devant lui et l'enfant prodigue y retrouva l'enthousiasme et la sympathie d'autrefois.
M. Goubert tenait à l'époque le café de France, que l'on avait surnommé le "gymnase des cafés-concerts." Il fut désireux de s'approprier le talent de Pacra, et il l'engagea pour deux ans.
Pacra, toujours avec un grand succès, y créa les saynètes charmantes qui s'appellent Un homme agaçant, la Servante maitresse, Roublard le canotier, Mademoiselle J'ordonne, etc., etc.
Au lieu de se fixer comma it aurait dû le faire, notre comique voyageur se laissa tenter par la pérégrination.
Ce fut le Hâvre qui eut gain de cause. Et ii y alla cueillir de nouveaux lauriers pendant les premiers mois de 1863. Ce fut pour lui plus qu'un succès de véritables ovations lui étaient faites chaque soir à la sortie du concert.
Revenu à Paris après l'expiration de son engagement, Pacra entra à l'Eldorado, le ler mai de la meme année.
Pendant deux années, it chanta, chaque fois
chaleureusement applaudi, cette petite chose intltulée Ça vous fait de l'effet.
C'est le meilleur brevet que l'on puisse donner de son talent, car Dieu sait si le public parisien se lasse vite, et facilement!
Un incident assez original vint divertir Pacra dans les commencements de. son engagement à l'Eldorado.
Le public se paye'parfois de cruelles fantaisies.
Un beau jour, on fit mourir Pacra.
Et le Théâtre, journal sans doute fort crédule, accueillit légèrement cette nouvelle et la publia :
"Pacra, ancien pensionnaire de Beaumarchais, de l'Ambigu-Comique, de feu le café du Géant et d'autres cafés-concerts, est mort ces jours-ci. Pacra jouait les comiques et disait la chansonnette."Disons, en passant, que l'oraison funèbre etait bien peu courtoise pour une personnalité aussi méritante.
Notre héros, qui n'entendait point la plaisanterie sur ce chapitre-là, écrivit immédiatement au journal pour démentir la fausse nouvelle. Et dans le numéro suivant it fut ressuscité.
1865 le vit à Marseille.
En 1866, it revint I l''Alcazar de Paris, où it
créa : Ce que c'est qu'un bonhomme, Mon Adèle, puis quelques saynètes, entre autres : la Femme modèle, la Diva Lucrezia.
Il fut après engagé au Casino de Bruxelles, où it passa huit mois, remplit de véritables triom-phes. D'ailleurs, avant son départ, les Bruxellois lui prouvèrent leur sympathie dans 'un concert d'adieu qui n'a pas eu de précédent.
V
Résolu à se fixer définitivement à Paris, il signa, le 16 septembre 1867, un engagement de trois ans avec M. Lorge, le directeur de l''Eldorado.
Ce concert est peut-être le seul où l'on déploie autant d'activité. L'intelligent directeur, qui ne recule devant aucun sacrifice, qui ne connait pas l'obstacle et qui, avant tout, veut contenter son public, exige de ses artistes le travail et l'aptitude. Gare aux impuissants !
Le nombre des créations qu'a faites Pacra à l'Eldorado depuis deux ans est innombrable. Nous ne citerons que les principales.
Jupiter et les poètes, Diogène, Mes habitudes, N'y touchez pas, Papa Mathieu, C'est un mystère, Le médecin me l'a défendu, le Père Loiseau, etc., etc. ? Voila la part de la chansonnette.
En fait de saynètes :
Deux Chanteurs sans place, Suzon, Entre deux vies, la Toquade du pacha, Un Drame au 5e étage, Jobin et Nanette, le Diable rouge, le Grand-papa de la Chan-son, la Tarentule, la Gamine.
Pacra est le chanteur de bon goût par excellence, et it faut espérer que la province ne nous l'enlevera plus et que les scènes parisiennes seules auront à se l'arracher.
VI [*]
Au privé, Pacra est le meilleur citoyen du monde. Je ne connais point de caractère plus doux et plus aimable que le sien. Serviable, excellent cœur, ami jusqu'à la tendresse, it n'a point d'ennemis.
Quelqu'un a dit sagement : "Le style c'est l'homme," j'ai un fragment de lettre de cet aimable artiste qui fera connaître son caractère mieux que les plus éloquents commentaires.
Après lui avoir demandé s'il n'avait point à s'opposer a ce que je publiasse une biographie de lui et m'informant de quelques points que j'étais aise qu'il me confirmât, voilà ce qu'il me re-pondit
"Maintenant, voulez-vous savoir que je me suis marié le 16 septembre 1856. J'ai fait mon devoir de citoyen en donnant au monde sept garçons et deux filles. Il me reste trois garcons et une petite fille aujourd'hui ; je vis avec mon père et ma mère (qui ont soixante-seize et soixante-dix-huit ans), au sein de ma famille dont je suis l'unique chef. C'est là que je place touter mes économies.
Ne trouvez-vous pas qu'il y a dans ces quelques lignes tout un
portrait ? Le cœur, la vie, l'amour, toursles sentiments n'y sont-ils pas peints, plus éloquents dans leur brieveté et dans leur accent que ne le sauraient faire un loquace biographe ?
Aussi, à tous égards, M. Pacra merite-t-il Bien et dignement l'estime que le public ne lui marchande pas d'ailleurs.
[*] Note des Auteurs : L'édition originale compte deux paragraphes numérotés V.Nous pensons que celui-ci, le suivant et dernier est le numéro VI.
PERRIN
I
Les vies, issues de cet instinct original et fatal qu'on appelle la vocation, sont généralement accidentées. Celle de M. Perrin est du nombre de celles-là
La lutte y est continuelle ; le triomphe et la soumission, la joie et l'affection s'y succèdent tour à tour; le rire s'y mêle aux larmes et les entraves souvent roidissent la volonté au point de la rendre opiniâtre.
"Etre acteur ! "est le rêve de bien des enfants.
C'est la bête noire de tous les parents.
Pourquoi ? On ne saurait vous le dire. Mais cela existe.
Jules Perrin est un Lyonnais. Il vint au monde le 9 juin 1839.
Son père était professeur de musique. On s'expliquera facilement que, connaissant les Sept notes de la gamme avant les vingt-cinq lettres de l'alphabet, it fut poursuivi par un irrésistible désir de chanter. Ses parents, ne se doutant pas de l'instinct pervers qu'ils développaient dans le cœur du bambin, encourageaient de touter leurs.
forces ces prédispositions naturelles, qu'ils admi-raient alors à l'état de prodige.
Rien n'est plus pernicieux que la vanité satisfaite d'un enfant. C'est la semence que vous en-tourez de soins, qui germe, croît et devient plante. Il ne faut plus s'étonner en suite que le gland que vows avez planté pour avoir un chêne ne produise pas un peuplier; de même que cat enfant chez qui l'art est inné, ne soit un artiste.
Le père de Jules, très-flatté des aptitudes musicales de son fils, lui apprit lui-même le violon. Et, nous dit Perrin, je m'accompagnais en chantant convenablement.
Des revers de famille firent qu'il apprit un état à dix ans, celui de graveur sur bois. Le burin et la pointe avaient succédé à l'archet ; mais le goût fort prononcé de l'art lyrique n'était point éteint pour cela chez lui. Et salon le proverbe : "L'on revient toujours à ses premières amours", Perrin n'avait pas totalement mis de côté la musique et le chant pour lesquels il entrenait non une simple sympathie, mais une véritable passion.
Le soir, après l'atelier, Jules courait au théâtre.
Là it apprenait l'art pratique que, dans sa chambrette, à huis-clos, it essayait lui-même ; il
s'incarnait dans la peau des jeunes premiers, et repétait avec accompagnement de gestes et force pas sur le parquet : Rachel, quand du Seigneur
La grâce tutélaire.....
Le sentiment de la gloire l'altérait. Lui aussi brûlait d'affronter la rampe et d'entendre sa voix couverte d'applaudissements chaleureux et enthousiastes, comme ceux qu'il administrait lui-même avec prodigalité aux interprètes qui le charmaient. Il rêvait de devenir premier ténor ?
A force de sollicitations, it parvint à obtenir l'emploi de flgurant au Grand-Théâtre de Lyon.
Ce jour-lit fut assurement le plus beau de sa vie.
Il fallait voir notre héros de douze ans, arpentant dignement la scène , s'agitant avec toute l'importance d'un premier rôle, et..... ne disant rien. Peu lui importait : le public le voyait. N'avait-il pas, pensait-il, quelque part aux bravos qu'on distribuait à l'ensemble des acteurs. Il se le persuadait.
Cela lui donna une flatteuse idée de sa personne; et, comme "l'appétit vient en mangeant", il_voulut un rôle aussi, ne fut-ce que quelques lignes , mais it voulait parler. Son directeur, moins enthousiaste de son talent que lui-même;
refusa net. Son âge , ses prétentions , firent même .
un peu rire celui-ci, ce qui choqua au suprême
degré M. Jules Perrin qui ne se jugeait pas le premier venu.
"Bast ! pensa-t-il, mon directeur n'y entend rien". Et il se consolait en pensant que les célébrités demeurent longtemps méconnues avant de percer.
Il eut connaissance d'un certain théâtre d'amateurs, où les chefs, moins rigides eu plus intern-gents, accepteraient peut-être son concours. Par l'intermédiaire et protection d'un camarade , it fut présenté et agréé comme sociétaire.
Là, chaque dimanche, devant un auditoire indulgent, compose de naïfs compagnons, Jules Perrin débitait force tirades, roucoulait force chansons. Il y était apprécié.
L'atelier avait bien un peu souffert de la carrière dramatique que Jules pratiquait en double, et son patron, homme superlativement prosaïque et peu crédule au génie de son apprenti, avait infligé de dures admonitions au jeune acteur. Perrin, assez consciencieux pour estimer qu'il ne trouverait pas d'appoin'ements dans une troupe, ne voulait pas briser subitement avec la gravure. Ces considérations éloquentes lui firent étouffer un moment ses aspirations idéales.
Le diable, dont le but est de tenter l'humanité, ne l'épargna pas non plus, et vint
sous la forme d'une nouvelle occasion.
Il y avait à Lyon une troupe ambulante de comédiens, qui donnait des représentations au théâtre militaire du camp de Sathonay. L'impressario en quête d'interprètes de bonne volonté faisait appel a tous les cœurs patriotiques autant qu'artistiques. Perrin qui entrevoyait l'honneur de faire partie d'un théâtre sérieux, n'eut garde de laisser passer une semblable occasion. Il fut engagé. ?Les appointements, bien entendu, n'etaient qu'en perspective. On jouait pour la gloire I
Perrin fit des concessions à la necessité, au bénéfice de l'amour-propre : son nom devait figurer sur une affiche ! ? Cela dura deux mois.
Avec les répétitions, les voyages, les représentations, vous pensez que la gravure n'allait guère. Pour comble de circonstances aggravantes , les terribles inondations de 1856 survinrent et engloutirent l'atelier ou it travaillait. Que faire ? jouer la comédie, lui sembla la solution la plus logique à donner à son interrogation, suivre sa vocation.
Voilà, donc notre ami Jules cheminant lestement par les rues de Lyon ; il . s'arrête devant un monument dont l'architecture indique l'utilité.
C'était le théâtre des Célestins. Le nom de Mélingue s'y pavanait en vedette; cela grandit l'opinion qu'il avait de sa personne en aiguisant encore le
désir qu'il nourrissait de devenir plus tard un disciple du grand comédien. Il entra.
A le voir sortir allègrement du Temple de l'Art, la mine épanouie, la tête haute et le sourire aux lèvres, il n'est point difficile d'en déduire que Jules était artiste dramatique.
Pendant un an, il s'acquitta de son modeste mandat, avec la piété et la conviction d'un lévite.
Ensuite, des Célestins it alla aux Bouffes-Lyonnais, théâtre de la galerie de l'Argue. Perrin avait du talent, certes ; et, en dépit du dicton qui prétend qu'on n'est jamais prophète en son pays, it devint rapidement populaire. Les dilettanti des Bouffes-Lyonnais se souviennent encore des interprétations et du succès de leur compatriote cette époque.
II
En 1859, etant tombé au sort, Perrin fut obligé d'échanger la gloire scénique pour les lauriers de Mars. Il lui fallut quitter ses chères Bouffes, ses adulations et ses bravos pour aller en Afrique rejoindre le 1er régiment de chasseurs à cheval, en garnison à Mostaganem. Là., il jouait le cavalier de 2ème classe, non au figuré, mais au propre.
Le réalisme soldatesque est peu compatible avec le vaporeux de l'Art. Et l'ennui et le découragement ne tardèrent pas à venir manger à sa gamelle.
Le colonel du ler chasseur était un homme du monde, fort courtisan des jouissances de la vie. Aussi, pour effacer le souvenir des lacunes locales et distraire son esprit du confortable de la patrie, avait il organisé, comme it arrive souvent, des distractions factices a son imagination. Il avait monté une musique.
Cela sourit à Perrin, et quoique it ne connût qu'un peu de violon, il sollicita hardiment la faveur d'y entrer.
Les régiments de cavalerie .n'ont pas de grosse-caisse, vu la difficulté de toucher de cet instrument à cheval. Cependant, le colonel désireux d'accéder au feu sacré de son subalterne, en créa pour lui l'emploi.
Perrin se trouvait au régiment avec un ancien camarade de Lyon, élève de Regnier au Conservatoire.
La sympathie mutuelle de leurs inclinations les faisait vivre en commun, en amis fraternels. L'i-dée leur vint de jouer la comédie ; c'était inévitable.
Le régiment campait dans des baraques en bois, ce qui se trouvait a merveille pour aider à l'érection d'un théâtre.
Un beau soir, sur une scène dressée avec les
matériaux de la Salle d'armes, ayant pour rideau deux couvertes de cheval glissant our des cordes fourrages, et des coulisses de feuilles d'aloès, M. Perrin et son ami donnèrent, devant un public étonné, une représentation composée des élé-ments les plus divers. ? On joua entre autres choses les Deux Aveugles. Bien entendu que livrets et partitions manquaient ; Perrin, avait donc appris à son camarade tout son rôle de mémoire, paroles et musique.
Mais le succès recompensa amplement les deux artistes et les applaudissements des copins, heureux de cette innovation récréative a leur profit, marquerent un enthousiasme qui allait jusqu'a l'ivresse. De leur cote, les artistes furent flattes an suprême degré.
Le bruit s'en repandit bien vite, et le colonel encouragea de son approbation ces louables tentatives. Une représentation à bénéfice, et sur le théâtre de la ville, fut même organisé par ses soins, s'en remettant pour le programme, les répétitions et la mise en scène aux connaissances de Perrin.
Cela fit sensation. On y prit goût, et les représentations se succédèrent les unes aux autres.
Sur ces entrefaites, les acteurs de la ville revinrent d'excursion, et Perrin en profita, car ses chefs l'autorisèrent à tenir un emploi dans la
troupe. Et le voilà jouant de nouveau le vaude-ville, la comédie, le drame et chantant l'opéra. Tout cela avait duré un an.
III
Perrin s'etant fait exonérer du service militaire, était revenu à Lyon. Mais son petit théâtre des Bouffes avait disparu dans l'haussmanisation de la ville. C'est alors qu'il entra au café-concert.
Il fit ses débuts au café-concert de l'Orphéon à Lyon ; it y resta dix-huit mois. Le succès qu'il obtint dans la chansonnette ne fut pas moindre que les lauriers qu'il avait cueillis sur la scène dramatique; cela lui fit prendre goût a cette nouvelle branche de l'Art, et il résolut de s'y consa-crer desormais.
Il partit pour Valence, alla à l'Alcazar de Marseille et de là au Havre.
Ce ne fut qu'en 1863 que Perrin vint à Paris. Il fit ses débuts au Palais d'Hiver (actuellement le Dix-neuvieme siècle). Il y resta une saison, pendant laquelle Is public parisien ratifia l'opinion de la province.
L'été suivant, le concert des Ambassadeurs, aux Champs-Elysées, l'accapara.
Puis enfin, en 1865, M. Perrin entra à l'Eldorado qu'il n'a plus quilté.
Tous les ans, M. Perrin a quatre mois de congé qu'il ne passe pas dans l'inaction, car c'est un piocheur.
En 1866, il a été à Saint-Petersbourg, et y fit applaudir la chansonnette en habit noir, chose plus difficile que l'on ne pense. Son succès y fut tel comme chanteur, que le directeur du Théâtre-Français lui fit les avances les plus séduisantes pour y jouer le répertoire des Bouffes. Mais Perrin aime la France et Paris avant tout, et nous est-il revenu.
Depuis il a toujours passé la saison d'été aux Ambassadeurs.
M. Perrin est un artiste du plus grand mérite ; au talent et à la science acquis, il joint le cachet du style et du bon goût. Ses œuvres sont marquees a son coin. Il a créé a l'Eldorado environ deux cents chansonnettes et quarante operettes. Point n'est besoin de les citer ; son nom est attaché à leur succès.
II est l'auteur d'une cinquantaine de romances, chansons et chansonnettes, dont it a compose la musique pour la plupart. Il a fait representer quatre operettes : Un Amour d'épicier.? Le souper d'Arlequin. ? La Leçon de musique et Prunelle et Piffard.
Perrin est aussi bouquiniste. Il possède peut-
être la plus riche et la plus rare bibliothèque artistique qui existe dans Paris. San avoir se monte a plus de quinze cents volumes, editions de luxe et editions tares.
Enfln, dois-je le dire ?
Perrin n'est point indifférent aux aménités du baron Brisse.
CHAILLIER
Il a paru de M. Chaillier une biographie fort compacte, volume spécial et personnel, dont le cadre, beaucoup plus étendu que le Nôtre, offre nécessairement plus de matières que cette publication.
Redire ici une grande partie des péripéties qui ont émaillé l'existence de cet artiste hors ligne, serait commettre un double emploi.
D'un autre coté, la personnalité de M. Chaillier est une figure trop essentielle an café-concert pour que, eu egard a cette considération, nous le passions absolument sons silence. Le mutisme serait une véritable lacune a notre galerie lyrique.
Nous nous bornerons à une appréciation.
Que dire en présence des ovations dont le public gratifie chaque soir le Petit bossu parisien ?
Le triomphe de Gustave Gustave Chaillier est le plus eloquent panégyrique.
Artiste dans l'ame, it doit son succes a une impérieuse vocation, a une foi énergique et inébranlable qui a su triompher des tâtonnements du début.
Et, aujourd'hui que le néophyte est arrive à l'apogée de sa réputation, aujourd'hui qu'il a son rang au nombre des célébrités parisiennes, it recueille la récompense d'une longue et pénible carrière.
Ce n'est pas la première fois que le théâtre et le café-concert font échange mutuellement d'artistes. Cependant c'est rendre un glorieux hommage à ces élus que, de leur sphère, les solliciter sur l'une, et l'autre de ces scènes; c'est affirmer la sanction publique. ? M. Chaillier, personnifie dans la pièce du Chatelet, Paris-Revue, représente le Petit bossu parisien. Il se sert nature.
Il ne répudie pas pour cela le café-concert pour embrasser le théâtre exclusivement. Il s'en gardera exclusivement bien, car it respecte et it aime avant tout le public qui lui a fait son suoces. Et il a raison.
Je m'appuie de l'appréciation et des citations de M. Léon Laroche pour analyser le caractère, les qualités et le talent de M. Chaillier, en priant l'auteur de ne point considérer nos emprunts comme un plagiat, mais pour la reconnaissance de son autorité, ce qu'ils sont.
"Le regard doux et vif, le front intelligent, la chevelure à la diable à la difformité dont il se moque avec une aisance et un brio fort spirituels, lui gagnent de suite les sympathies. Sa voix, juste
agréable, une note particulière, audacieusement donnée toujours, lui acquiert tous les suffrages. Un répertoire fort original, où les points abondent, où les traits fourmillent, et qu'il débite avec l'art du comédien, voila ce qui a fait de Chaillier une de nos célébrities parisiennes. Celui qu'on a surnommé le Petit bossu parisien est doux, affable ; il cause peu, réfléchit beaucoup, pense juste et s'exprime Bien. Elevé dans la misère, il en connait à fond toutes les souffrances, toutes les tortures, et, aeur bon et généreux, it se montre toujours prêt à soulager ceux que l'infortune frappe inexorablement. Esprit élevé et fin, Chaillier a toujours été l'homme de ses œuvres. C'est grâce a ses études incessantes, à son travail continuel, qu'il est parvenu a être un artiste de talent et de mérite.
"Doué d'une intelligence exceptionnelle, il appris tout ce qu'il salt, seul et à force de perséverance; puis il s'est fait un répertoire dont il a composé lui-même la musique. En somme, Chaillier, qui a beaucoup travaillé, bon musicien, ex-cellent chanteur, diseur de la bonne école, est ce qu'il mérite d'être, l'enfant gâté du public".
ALEXANDRE GUYON
I
II y a longtemps déjà qu'est scellée, l'alliance entre le Théâtre et le Café-concert. M. Guyon est un transfuge du théâtre et, certes, it n'est point déplacé à l'Eldorado,
Aujourd'hui que le préjugé, ce prude qui n'a point d'excuse a son absurdité, est tombé en désuétude, l'artiste ne déroge pas, comme autrefois. Il peut même monter du théâtre au café-concert. Le Progrès, en faisant le jour sur certaines opinions systématiques qu'on laissait complaisamment reléguées sous leur couvercle antique, a égalisé tous les niveaux.
Renard, Suzanne Lagier, Chrétienno, Lasseny et aussi M. Guyon ont fait merci de cette prévention, qui s'accoutrait du pseudonyme de Dignité. Et le public, loin de désapprouver, a applaudi.
Le procès du préjugé est fait. Passons.
II
Alexandre Guyon vit le jour a Paris, le 26 février 1829, dans une maison située place de La-fayette, au n? 4.
Alexandre Guyon est une de ces Étoiles à vocation, dont les aspirations, comprimées d'abord par la volonté paternelle, finissent toujours par triompher.
Il fit donc ses premiers pas comme apprenti bijoutier. Il avait douze ans.
Son patron s'apercevant des dispositions de son (élève pour tout autre chose que la bijouterie, l'engagea à chercher une place. Il ne se le fit pas dire deux fois.
Il devint apprenti ciseleur. ? L'art qui a pour sceptre le burin, lui semblait une profession plus noble et plus digne de ses penchants : i burina avec enthousiasme. Puis le soir, it allait se délasser des fatigues du jour au théâtre.
La scène fascine les imaginations ardentes et, pour peu qu'on possède dejà, inné en soi, l'amour dramatique, ce sentiment se développe bientôt sous l'éclat du lustre à l'état de passion. De là à débuter it n'y a qu'un pas. C'est ce que fit Alexandre.
Admirateur fervent de Debureau,le paradis des Funambules le voyait chaque soir a son poste, monomane de l'art.
Par l'intermédiaire d'un protecteur influent, it obtint un beau jour l'emploi de figurant. Sa joie
était grande., certes. Mais quelques jours après elle fut porté à son comble.
Guyon, qui brûlait de figurer dans une pièce parlante, s'exercait chez lui, avec toute la gravité d'un acteur important, à énoncer correctement le :
"Seigneur, c'est une lettre,
"Qu'en vos mains à l'instant..., etc."
Un rôle ! c'etait le couronnement de ses ambitions. Un rôle I c'etait l'attention du public, une impression quelconque, le bravo, l'ovation peut-être. Un rôle! c'était la gloire.
Parvenu à la perfection dans l'art de dire "Seigneur, c'est une lettre," convaincu désormais du talent qu'il avait laborieusement conquis, it sollicita de son directeur un rôle, ce rêve du néophyte ; un rôle qui allait le sortir du néant, le
faire connaitre !
M. Billon accéda et satisfit les nobles aspirations de l'artiste en lui confiant l'objet de tous ses désirs : un rôle d'une ligne.
Fier, heureux, il travailla consciencieusement cette Création (c'était une création). Bref, devant une salle pleine, avec la conviction d'un Frédérick Lemaître, it s'en tira à la satisfaction générale.
Guyon était sacré acteur.
Puis le talent, qui seconda si bien sa vocation, le fit progresser, et de fil en aiguille it arriva jouer un rôle de cinq cents lignes.
Un M. Etienne, directeur du Théâtre des Singes
et des Chiens savants, créa une nouvelle exploitation sous le nom de : Théâitre des Patriotes. Il engagea notre héros pour jouer la comédie et les pierrots. Depuis Debureau, l'emploi des Pierrots était classé.
La Révolution de 1848 fit fermer le théâtre des Patriotes, et Guyon se réfugia au Lazary.?C'était un peu déchoir.
Aussi n'y demeura-t-il que trois mois. Les spectacles-concerts commen?alent à poindre le Café de France avait alors une certaine renommée de high life qui séduisit. Alexandre.
Il fut engagé pour jouer les Pierrots et son nom fut mis en vedette sur l'affiche. Il se fit applaudir comme mime dans de fort amusantes interprétations. Ii avait assis les bases de sa réputation.
Il entrevoyait déjà, un avenir des plus brillants, faisait des rêves dorés et construisait force châteaux en Espagne. Une catastrophe imprévue vint culbuter tout cela et déranger entièrement les plans glorieux dont son imagination l'avait bercé. ? Le Café de France ferma.
Guyon restait sur le pavé.
Il revint alors aux Funambules. Il joua dans les Trois Pierrots et fut remarqué a côté de Debureau fils, ce qui était quelque chose.
Ce dernier vint à tomber malade. Guyon le rempla?a pendant pès d'un mois et les titis, appréciateurs éclairés de ce genre de spectacle, lui firent plus d'une fois l'honneur de le rappeler.
Alexandre Guyon allait avoir vingt-et-un ans. Et le tirage au sort n'était pas sans l'effrayer. Disons tout de suite que ses appréhensions furent legitimées, car it amena le numéro 4.
Conscrit ! ? Il fallait rengaîner la vocation dans le fourreau de l'Oubli, dire adieu au succès qui commen?ait a accourir, faire un paquet de ses espérances et embolter le pas a la Réalité. Dame !
Alexandre avait le cœur gros, bien gros; it versa d'abondantes larmes.
La Providence vint à son secours sous la forme de son directeur. M. Billion lui accorda généreusement une représentation à bénéfice, qui lui permit de se faire remplacer.
Guyon put donc continuer sa carrière dramatique. C'est alors qu'il entra aux Délassements-Comiques [*].
A partir de cette époque, Guyon avait su saisir le succès, et ses créations se comptaient déjà. Il créa à ce théâtre un bon type de sergent dans Manon de Nivelle; quatre rôles différents dans Lisette ; un pierrot ? encore un pierrot ? dans Dormez mes petits amours. Il s'y fit aussi remarquer par son talent d'imitation.
Après les Délassements, M. Mourier, des Folies Dramatiques, l'engagea. Guénée et Potier, Allons-y
gaiement, furent pour lui des succès étourdissants. Dans l'Avocat des pauvres, it imita Mélingue avec un talent sans pareil. Ensuite, sous la direction de M. Harel, Guyon créa le rôle de Clodion dans l'Histoire d'un gilet, dont it fit un type du rupin déjà mûr, des plus originaux et d'une grande sincérité de détails; sa gaieté communicative et sa, verve excentrique ont donné à cette physionomie un cachet tout particulier. Cette création le pla?a immediatement au nombre de nos bons comiques de genre.
Dès lors Guyon commence a faire partie de ces élus aimés du public et dont la sympathie est le meilleur passe-port pour la célébrité.
C'est alors qu'il épousa Mlle Pauline Jarry, pensionnaire aussi des Folies Dramatiques, et dont le nom est applaudi depuis dix ans sur cette scène.
Singulière particularité : Alexandre Alexandre Guyon est né place Lafayette, numéro quatre; a tiré le quatre mars à la conscription, et a amené le numéro quatre; enfin it s'est marié le quatre mai. Il ne lni reste plus qu'a, mourir... la semaine des quatre jeudis.
Engagé aux Variétés, il y a occupé une place importante, et par son merite et par son talent. Il y fit ses debuts dans le Retameur, ou it obtint un
grand et légitime succès, qu'il ne dementit point durant son long passage our la scene du boule-vard Montmartre. Au nombre je citerai : une Semaine à Londres, les Médecins, la Revue au cinquième étage, Crockbett et ses lions, Une femme dégelée, le Photographe, la Liberté des théâtres. Mentionnons, en passant, que dans cette dernière pièce où it jouait le rôle de Briolet, il a remplacé au pied-levé Dupuis, charge de l'emploi principal, et en-suite Hervé dans le sien.
Dans la Belle Helène, it a rempli, sans. désemparer quatre cents fois le role du bouillant Achille.
Quelque temps après, dans Barbe Bleue, Dupuis étant tombé malade, il s'incarna dans le rôle de Barbe Bleue, du jour au lendemain.
M. Guyon, en outre de son talent véritable et distingué, est aussi un piocheur infatigable, que rien n'épouvante. Avec de semblables passeports, on ne peut que légitimer les faveurs que le public décerne généralement avec une si scrupuleuse parcimonie. Si un artiste en fut digne, c'est bien, certes, M. Guyon.
Nous avons encore tout.frais à la mémoire le succès qu'il a obtenu l'ann?e dernière dans cette désopilante Revue intitulée : le mot de la fin, et dans laquelle it faisait une imitation d'Hervé dans Chilpéric, à s'y tromper.
Guyon a succèdé à Couderc dans la Vieillesse
de Brididi; à Grenier, dans le rôle de Boiret de l'Homme n'est pas parfait; à Kopp, dans le Joueur de flûte; à Christian, dans !'Hercule et une jolie femme.
Comme on le voit par cette abondante nomenclature, la carrière dramatique de M. Guyon est des plus et des mieux remplies.
La dernière cr?ation de Guyon au th?âtre a été Déjazet, tout dernièrement, dans la pièce de Victorien Sardou : Monsieur Garat, ou it jouait Vestris, en représentation avec Déjazet.
Les offres brillantes de M. Lorge l'ont séduit. On salt que le directeur de l'Eldorado ne recule devant aucun sacrifice pour s'attacher nos meil-leurs artistes des scènes parisiennes. Et bien lui en a pris pour celui-ci.
M. Guyon n'a point abandonné le théâtre pour cela, car M. Bertrand, son directeur, tient toujours la place à son bon gré.
L'Eldorado a fait un chaleureux accueil à cet illustre nouveau venu. Aussi l'artiste a-t-il manifesté sa reconnaissance en gratifiant le public d'une nouvelle scène d'imitations, primeur de gourmet, et dont l'artiste est lui-même l'auteur.
Hercule aux pieds d'Omphale et Poète et Savetier, deux saynetes pleines de sel, et d'esprit, accomodées de bonne musique; le fort de la halle, un
type des plus réussis, dans la Gamine; ont obtenu un grand succès.
Je ne veux point omettre non plus Paris qui marche, une tres-longue, mais très-désopilante chansonnette mimée, dans laquelle l'artiste nous fait passer en revue lee personnalités les plus ex-centriques et les plus divertissantes.
On ne saurait passer sous silence son remarquable talent d'imitation. C'est un art. ? Une autre particularité, non moins saillante, est son aptitude, je devrais dire : instinct musical. Il y a quelques années, aux Variétés, dans une pièce ayant pour titre la Liberté des théâtres , Guyon jouait du piano et conduisait l'orchestre, sans connaitre une note de musique. Qu'on lui joue sur un violon un air quelconque, le premier venu, une improvisation même, et immédiatement après, Guyon répétera littéralement le morceau. Ceci sort du domaine de la science ; c'est un don de nature, un instinct propre. Demandez lui son secret ; it ne saura pas ce que vous voulez lui dire.
Alexandre Guyon n'est pas a proprement parler une étoile du Café-concert, puisqu'il n'y est quo depuis le mois de septembre. Peu importe ! c'est une étoile lyrique et un excellent artiste, a coup sûr. Et puisqu'il nous a ?t? donné la bonne fortune de le posséder, je m'en empare avec empressement. Ces oiseaux-là sont rares, lecteurs.
DUHEM
? Connaissez-vous M. Duhem ?
? Ah I je crois bien : c'est un des nôtres.
? Comment cela ?
? Oui, c'est lui qui nous a immortalisés (sic). Mon interlocuteur était un Conducteur d'omnibus.
L'artiste, en effet, qui répond au nom de Duhem, est un de ces bons chanteurs que la province méconnait quelquefois. Aussi n'aspirent-ils qu'à figurer sur une scène plus élevée. Non point que Duhem ait ?t? sifflé partout où it a ?t?; au contraire : it a ?t? partout applaudi. Mais ces bravos de province n'ont point de retentissement, et tout ce que Paris ignore est bel et bien ignoré.
Emile Duhem, qui est né le 5 mars 1843 a Wattignies, a debuté à Lille au Concert du XIXe Siècle. Il avait alors vingt ans. Son talent, qui y ?tait estimé et des plus goûtés, le fit rester six ans dans le même établissement.
Parlez à un Lillois de Duhem, et vous verrez quelles litanies de louanges it vous récitera. C'est que l'artiste dont nous esquissons a grands traits la vie, n'est point un de ces chanteurs, errant de province en province et de ville en ville, se souciant peu de l'approbation ou du désaveu de son public; Duhem est un artiste consciencieux avant tout. Son devoir est de satisfaire ceux qui viennent l'écouter, son amour-propre de chanteur le fait toujours cheroher le mieux. Et it sait contenter la fois le public et lui-meme. Rien qu'i ce titre merite-t-il de figurer au nombre des ohanteurs populaires.
Enfin it quitta Lille pour aller à Strasbourg, où le succès l'attendait encore. Il parcourut ainsi la Suisse, Lyon, Rouen et nos principales villes de France [*]. L'Alcazar de-Bruxelles le posséda aussi.
Dans cette dernière vile, it lui arriva une sin-gulière aventure, qui fait époque dans sa vie, et qui certes mérite mention.
Duhem est doué d'un talent de société peu commun. Il imite avec la voix le son de la flute a s'y meprendre.
Cet agrément vocal fat la cause d'un pari entre un Hollandais et un Anglais. Ce dernier avait gagé que, pour imiter la modulation de cet instrument, it se servait d'un objet quelconque qu'il in-troduisait préalablement dans sa bouche. Le Hollandais, soit qu'il le sut ou non, peut-être histoire de parier, affirma le contraire. 1,000 francs et un souper furent l'enjeu. Bien entendu que l'artiste en ?tait.
Au dessert, moment qu'on avait choisi pour vider la question, Duhem se leva et exécuta ainsi une fantaisie de sa composition, au grand étonnement des soupeurs. Iol était évident qu'il n'avait usé d'aucun moyen de supercherie , et l'Anglais en acquit à ses dépens la preuve.
Ce ne fut que quelque temps plus tard
vint a Paris, l'année dernière, trouver M. Lorge. Le 16 mai 1869, it signa son engagement a l'Eldorado.
Quoiqu'il n'y ait que peu de temps que M. Duhem ait donné preuve de son talent sur une scène parisienne, mais la première, nous pouvons augurer d'avance une carrière brillante pour lui.
Son apparition a fait sensation des le premier jour. Et depuis, chacune de sea créations est un succes.
Le Conducteur d'omnibus, le Bouton de Billou , l'Afficheur, le Parfait Cuisinier, l'Allumeur de r?verbères, le Cantonnier ,de Paris, etc., ont ete des re-frains populaires, qu'on entendait dans toutes les bouches et dans toutes les rues ; et tout récem-ment encore l'Allumeur de réverbères et le Brosseur du Capitaine, sont venus confirmer sa réputation.
Mais incontestablement, le Conducteur d'omnibus a Re l'objet d'une véritable scie, ce qui se traduit par grand succès.
D'ailleurs la corporation apologiée lui a offert
un témoignage glorieux de sa satisfaction en lui adressant une magnifique couronne, sur laquelle est tracée cette inscription : A Monsieur EMILE DUHEM, les Conducteurs d'omnibus reconnaissants.
Cette marque de sympathie est un véritable trophée pour un débutant à Paris.
Duhem est le createur du type populaire. Il est a tous égards un véritable chanteur populaire.
VIALLA
Pierre Vialla est né à Montpellier le 20 septembre 1835.
Dès qu'il put voler de ses propres ailes, il battit la province en qualité de fort ténor et obtint de beaux succès dans les premières villes de France : Lyon, Bordeaux, Marseille, le Havre, Rouen.
Peu ambitieux, it ne rêvait point la gloire et semblait vouloir l'ignorer. Mais le public de l'Eldorado,lui a fait heureusement changer d'avis.
Venu pour la première fois sur une scène parisienne, il y a deux mois, M. Vialla a débuté d'emblée par l'Eldorado, où il a rencontré de véritables appréciateurs de son talent et de son mérite.
Ce genre d'emploi pour lequel l'auditoire est généralement difficile, avec juste raison, est un écueil bien souvent ; mais M. Vialla, qui est doué de véritables qualités, a su s'y faire remarquer dès son début. Et c'est avec une sincère satisfaction que nous le voyons figurer dans la troupe, vraiment d'élite, de M. Lorge.
Généralement le café-concert, où le public vient pour se dérider, est une roche tarpéienne pour les artistes de son emploi.
Un ténor ? un chanteur sérieux !
C'est que M. Vialla n'est pas un chanteur banal. Ses qualités vocales sont riches; sa voix est souple et nerveuse à la fois, large, étendue ; et, où l'on a pu le mieux juger de sa puissance, c'est dans sa dernière création : Notre-Dame de Paris, chant patriotique où il a su developper avec une ampleur digne de mention, toutes ses qualités.
Ce morceau, du reste, écrit spécialement pour lui, est d'une manière savante et élevée, et je doute qu'un ténor ordinaire puisse s'en tirer, je ne dirai pas avec la supériorité de M. Vialla, mais même quelque peu avantageusement.
M. Vialla nous promet beaucoup, et, quoique jeune pensionnaire de l'Eldorado , n'en est pas moins un artiste émérite. D'ailleurs l'accueil sympathique dont le public le gratifie quotidiennement est le meilleur passe-port qu'on puisse invoquer pour l'avenir.
JULES RÉVAL
Jules Réval est un comique excentrique et assurément le plus excentrique des comiques.
Il est né à Montpellier, le 11 mai 1836.
Dès l'âge de treize ans it entra comme élève à la manufacture de pianos de la maison Érard. Il y resta jusqu'à vingt-six ans.
Un jour qu'il se trouvait légèrement... ému , ayant toujours'cultivé le chant et jouissant parmi ses camarades d'une certaine réputation de chanteur comique, il quitta la maison Érard et s'engagea au café-concert.
Il débuta à l'Alhambra , sous la direction de M. Maxime Leprovost; puis, en province, alla l'Alcazar du Mans; ensuite au Hâvre. Se sentant doué d'un talent véritable, it prit la résolution de se fixer à Paris, fit trois saisons d'été aux Ambassadeurs, puis ouvrit les Folies-Bergère. Ses principales créations ont été, dans la chansonnette le Quoique Auvergnat, Un Fichu Nez, le Guerrier de Monaco ; dans l'opérette : le rôle de Mouchamiello dans le Docteur Purgandi, la parodie de Patrie ! Quarante de Bézigue, Hussard et Fantassin.
Le genre comique est une spécialité, chez les chanteurs, généralement privilégiée. Ils sont type. Il se dégage dans leur physionomie on darts leur
maniere un je ne sais quoi qui fait infailliblement éclore l'hilarité sur les lèvres des spectateurs. ?Le nez d'Hyacinthe, l'expression naïve d'Arnal, la désinvolture de Lesueur atteignent au premier abord le public; la seule exhibition, sans mot dire, de ces trésors d'excentricité désopilent la rate. Les jambes de Réval, qu'on pourrait sans hyperbole qualifier de flûtes, sont un de ces trésors dont l'exagération comique excite le fou-rire.
Réval entrant en scène avec ses flûtes soulève l'hilarité d'une salle entière. Et pour tout vous dire, il a 1 mètre 72 centimètres de taille.
Ceci n'est qu'un don de nature, heureux qui en est doué. Mais cela ne retire en rien du mérite et du talent de l'artiste. C'est une qualité naturelle et inconsciente dont l'individu profite, mais sans en exploiter les avantages.
L'Eldorado a ceci de particulier, que dans la pluralité des pensionnaires qui composent sa troupe, pas un artiste ne jouit d'un genre semblable ; chacun d'eux possède, sa specialité, particuliere et personnelle, et chacun y est maître.
M. Réval a déjà commis une carrière laborieuse. Dans son rôle de comique excentrique, il a ré-vélé, depuis le court espace de temps qu'il est engagé à l'Eldorado, non-seulement des qualités notables, mais assurément une superiorité digne de mention.
_____________
|